1
- Problèmes environnementaux, une réalité
A
- Qu'est ce que l'environnement ? Le développement ?
1)
Deux concepts différents...
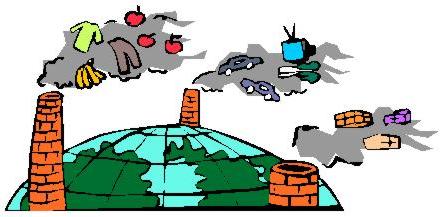 Développement
: selon la définition classique d'un dictionnaire économique,
F.PELVOUX définit le développement comme «
l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes
sociales qui permettent la croissance du produit réel global
». Il ne faut pas confondre le développement avec la
croissance économique pure et simple qui ne représente
qu'un enrichissement.
Développement
: selon la définition classique d'un dictionnaire économique,
F.PELVOUX définit le développement comme «
l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes
sociales qui permettent la croissance du produit réel global
». Il ne faut pas confondre le développement avec la
croissance économique pure et simple qui ne représente
qu'un enrichissement.
Environnement
: La définition du petit Robert définie l'environnement
comme étant « l'ensemble des conditions naturelles et
culturelles dans lesquelles les organismes vivants se développent
». Nous avons déjà ici l'idée de
développement. Le développement au sein d'un milieu,
celui qui nous à fait naître et qui est une condition
obligatoire de notre survie.
Voyons
en quoi ces 2 définitions sont liées, ou en quoi notre
développement aussi complexe soit-il s'inscrit dans
l'évolution de la nature comme toutes espèce vivante.
2)
... mais liés
La
croissance économique est un phénomène récent
(depuis1500). Au départ le capitalisme était fondé
sur les exploitations minières et forestières, et ce
n'est que vers 1700 que se modifient techniques et organisations de
la production grâce aux révolutions industrielles et
agricole. Avec l'accès au développement « à
l'occidentale » du Japon et des USA , la pression sur
l'environnement et les ressources se fait de plus en plus forte.
a
) Le principe de la thermodynamique de l'environnement
Vers
1960 on assiste à un retour des idées malthusiennes,
c'est-à-dire que l'on considère l'environnement comme
étant une limite aux possibilités de production et de
consommation. On arrive ainsi à la déduction d'une
égalité comptable entre la somme des ressources
naturelles et la somme des biens consommés. Le raisonnement se
fait en économie fermée où tout ce qui est
produit peut être retranché aux ressources disponibles,
dans un tel système l'énergie se dégrade
inexorablement. On met ainsi l'accent sur les coûts en terme
physique de la croissance économique qui accélèrent
le processus de dégradation de l'environnement.
 De
plus, un problème apparaît avec l'accumulation des
déchets qui menacent les capacités d'épuration
des milieux naturels. En cela, l'approche de l'économie
écologique a le mérite d'introduire les contraintes
environnementales en analyse économique. On peut prendre
l'exemple de l'eau qui, si elle est polluée, engendre d'autres
externalités négatives pour la pêche, les
baignades, etc...
De
plus, un problème apparaît avec l'accumulation des
déchets qui menacent les capacités d'épuration
des milieux naturels. En cela, l'approche de l'économie
écologique a le mérite d'introduire les contraintes
environnementales en analyse économique. On peut prendre
l'exemple de l'eau qui, si elle est polluée, engendre d'autres
externalités négatives pour la pêche, les
baignades, etc...
b
) Politique environnementale et développement
durable
En
1971 création en France du ministère de la protection
de la nature et de l'environnement.
En
1970 création aux USA de « l'environmental protection
agency »
Il
y a une double raison à la création de ces institutions
; une raison éthique tout d'abord, pour le bien des
populations, et un raison économique :
Les
effets de la pollution se traduisent par des coûts importants
sur la santé humaine, mais aussi des coûts de
dépollution des milieux naturels.
Ainsi
un investissement dans des technologies respectueuses de
l'environnement peut mener à une croissance de l'efficacité
de l'économie. On va chercher à réduire les
risques en consacrant une part du PIB à la protection de
l'environnement (eau, assainissement, nuisances, déchets ...).
 En
1987 les Nations Unies créent la commission sur
l'environnement et le développement, d'où émerge
le premier concept de développement durable dont l'objectif et
de satisfaire les besoins présents sans compromettre les
générations futures. Les objectifs premiers du
développement durable sont donc l'équité
inter-générationnelle et la répartition
équitable entre régions et pays du monde.
En
1987 les Nations Unies créent la commission sur
l'environnement et le développement, d'où émerge
le premier concept de développement durable dont l'objectif et
de satisfaire les besoins présents sans compromettre les
générations futures. Les objectifs premiers du
développement durable sont donc l'équité
inter-générationnelle et la répartition
équitable entre régions et pays du monde.
Trois
conditions s'avèrent primordiales pour satisfaire ce double
objectif :
Qualité
de vie stable (interaction économie et biosphère)
Accès
aux ressources naturelles égalitaire (équité
dans le temps et l'espace)
Ne
pas endommager de façon persistante l'environnement (prise en
compte du long terme).
De
plus, il faut souligner que l'état semble être le seul à
pouvoir se charger de cette tâche pour le développement
durable parce que : les problèmes environnementaux touchent
tout le monde, les ressources sont des biens collectifs, les
problèmes de pollution impliquent trop de responsables pour
une solution strictement juridique.
Ces
problèmes, malheureusement souvent banalisés, sont
hélas une triste réalité. L'heure ne devrait pas
être à savoir qui est le plus gros pollueur, mais à
la recherche active de solutions viables et durables.
B
- Les constats, 10 ans après RIO.
 «
Terriens, la planète fout le camp », s'est ainsi que fut
tirée la sonnette d'alarme à Rio de Janeiro, le premier
sommet de la terre en 1992, et ainsi qu'elle l'a été
régulièrement depuis, tant et si bien comme le souligne
un journaliste « d'Alternatives-économiques » que
le ressort en semble cassé : le climat qui se réchauffe,
l'eau douce qui se raréfie et 1.2 million de personne vivant
toujours avec moins de 1$ par jour .
«
Terriens, la planète fout le camp », s'est ainsi que fut
tirée la sonnette d'alarme à Rio de Janeiro, le premier
sommet de la terre en 1992, et ainsi qu'elle l'a été
régulièrement depuis, tant et si bien comme le souligne
un journaliste « d'Alternatives-économiques » que
le ressort en semble cassé : le climat qui se réchauffe,
l'eau douce qui se raréfie et 1.2 million de personne vivant
toujours avec moins de 1$ par jour .
En
effet, les espoir nés à Rio ont été en
grande partie déçus. Voici les constats fait à
Johannesburg montrant en quoi il faut modifier plus que jamais les
modes de développement au nord comme au sud afin de préserver
la survie des générations futures.
Ce
sont des constats assez noirs réalisés par quelques 170
pays qui étaient présents à Rio en 92, alors que
tous semblaient s'accorder sur la nécessité de protéger
la planète pour protéger l'humanité ; c'est à
dire un double objectif de « protection de l'environnement »
et d' « élimination de la pauvreté »,
supposant des modes de production ne détruisant et
n'affaiblissant plus les ressources naturelles. Tous s'accordent sur
ces faits, mais les actes manquent encore.
1er
constat : De très fortes inégalités entre
riches et pauvres
Selon
les donnés de la banque centrale (www.worldbank.org)
la proportion des gens qui subsistent avec mois de 1 $ par jour à
été ramenée de 29% à 23% en 1998. De plus
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a nettement
diminué depuis 1990 (sauf en Afrique), le taux d'équipement
a augmenté durant les dix dernières années et le
nombre d'enfants fréquentant l'école primaire à
augmenté... Ces constats pourraient être satisfaisant
s'il ne restait pas l'autre côté de la balance. C'est à
dire que 110 millions d'enfant ne vont toujours pas à l'école,
que 20% des enfants n'atteignent pas leur cinquième année
dans les pays pauvres alors que 1% meurent avant 5 ans dans les pays
riches.
 L'espérance
de vie a encore baissé sur le continent africain passant de 50
à 47 ans. La cause en est du sida avec 40 millions de
séropositifs dans le monde dont 96% dans le sud
(www.unaids.org),
et de l'eau polluée (2.2 millions de morts par an) sans parler
des bactéries plus communes dues au manque d'hygiène
qui continuent de tuer (1.1 millions n'ont pas accès à
l'eau potable et 2.4 millions ne peuvent jamais se laver).
L'espérance
de vie a encore baissé sur le continent africain passant de 50
à 47 ans. La cause en est du sida avec 40 millions de
séropositifs dans le monde dont 96% dans le sud
(www.unaids.org),
et de l'eau polluée (2.2 millions de morts par an) sans parler
des bactéries plus communes dues au manque d'hygiène
qui continuent de tuer (1.1 millions n'ont pas accès à
l'eau potable et 2.4 millions ne peuvent jamais se laver).
Enfin,
il y a certes une baisse du taux de personne vivant avec moins de 1$
par jour (voir plus haut), mais qui à cause de la
croissance démographique n'a fait que passer de 1.3 à
1.2 milliards de personnes. En Afrique subsaharienne, plus d'un
habitant sur 2 est sous le seuil de pauvreté et 1/3 des
africains sont sous alimentés. Même si la tendance est à
la baisse dans le monde 815 millions de personnes dans le monde
souffrent de malnutrition.
2ème
constat : La croissance polluante
Effectivement,
le sommet de Rio avait permis de s'entendre sur 2 conventions. La
première concernant les changements climatiques, la seconde la
biodiversité.
 Pour
les risques climatiques, les états les plus riches étaient
contraints de ramener leur niveau d'émission de gaz à
effet de serre à celui de 1990. Elle a été
complété par le protocole de Kyoto en 1997, obligeant
ces mêmes pays riches à être en 2012 5% en dessous
du niveau de 1990 ; chaque pays s'était vu imposé d'un
objectif chiffré , avec la possibilité d'échanger
avec d'autres pays des droits ou d'en obtenir en investissant dans le
développement durable des pays pauvres. Cependant, les
principaux intéressés que sont les Etats-Unis en tant
que premier pollueur mondial ont rejeté le protocole en mars
2001. Les experts estiment que les émissions devraient être
divisées par 2 pour stabiliser le dérèglement du
climat.
Pour
les risques climatiques, les états les plus riches étaient
contraints de ramener leur niveau d'émission de gaz à
effet de serre à celui de 1990. Elle a été
complété par le protocole de Kyoto en 1997, obligeant
ces mêmes pays riches à être en 2012 5% en dessous
du niveau de 1990 ; chaque pays s'était vu imposé d'un
objectif chiffré , avec la possibilité d'échanger
avec d'autres pays des droits ou d'en obtenir en investissant dans le
développement durable des pays pauvres. Cependant, les
principaux intéressés que sont les Etats-Unis en tant
que premier pollueur mondial ont rejeté le protocole en mars
2001. Les experts estiment que les émissions devraient être
divisées par 2 pour stabiliser le dérèglement du
climat.
En
ce qui concerne la biodiversité, la convention a été
ratifiée par 180 pays exceptés...les Etats-Unis. Elle
vise à conserver et privilégier la diversité
biologique ainsi que le partage de ses avantages. Cependant ce texte
ne comporte pour seule contrainte que le sujet des O.G.M., le reste
représente une simple déclaration d'intention. La
conférence de la Haye en 2002 a permis aux ministres de
l'environnement présents de décider l'intensification
du mouvement. Pour le partage de la biodiversité, ils
prévoient que les pays d'où la ressource est tirée
reçoivent une part de ce qui est extrait... Mais là
encore, aucune législation contraignante, de simples brevets
permettraient de contourner l'obstacle.
La
conférence de Rio reconnaissait la différence de
puissance des pays dans l'action environnementale, donnant à
chacun des responsabilités en accord avec ses capacités.
Les pays riches ayant la plus lourde des responsabilités dans
l'épuisement de la planète, les mesures les plus
contraignantes leur ont été allouées. Ils
doivent aider les pays pauvres et leur montrer la voie à
suivre... Malheureusement, le fait que les pays riches n'aient pas
baissé leur niveau de consommation et de production
destructeur de l'environnement et des ressources ne pouvait donner
d'effet positif.
 L'exemple
en France : d'après l'institut français de
l'environnement (Ifen) dans son rapport
1998-2001(www.ifen.fr/ree2002/),
les quantités de CO2 continuent d'augmenter au même
rythme que la consommation sans qu'on parvienne à les
déconnecter. Seuls certains secteurs commencent à
connaître un découplage entre les activités
économiques et ses effets sur l'environnement. Si l'air en
ville est encore respirable, c'est grâce au pot catalytique, à
l'essence sans plomb et au durcissement des normes européennes
sur les véhicules. Cependant on remarque que les évolutions
sont très rarement dues à des changements de
comportements. Alors que les pays riches représentent
seulement 20% de la population mondiale, ils produisent et consomment
85% des produits chimiques synthétiques, 80% de l'énergie
commerciale ou encore 40% de l'eau douce (www.environnement.gouv.fr),
leurs émissions de gaz à effet de serre sont dix fois
plus élevées que celles des pays pauvres. Les pays
émergeants du sud ont tendance à suivre cet exemple.
Lorsqu'ils parviennent à s'engager sur un sentier de
croissance économique soutenue c'est souvent au détriment
total de l'environnement ; et si beaucoup de pays du sud n'ont pas
accrus leur consommation d'énergie ou leur émission de
polluants, c'est plus par impuissance que par choix.
L'exemple
en France : d'après l'institut français de
l'environnement (Ifen) dans son rapport
1998-2001(www.ifen.fr/ree2002/),
les quantités de CO2 continuent d'augmenter au même
rythme que la consommation sans qu'on parvienne à les
déconnecter. Seuls certains secteurs commencent à
connaître un découplage entre les activités
économiques et ses effets sur l'environnement. Si l'air en
ville est encore respirable, c'est grâce au pot catalytique, à
l'essence sans plomb et au durcissement des normes européennes
sur les véhicules. Cependant on remarque que les évolutions
sont très rarement dues à des changements de
comportements. Alors que les pays riches représentent
seulement 20% de la population mondiale, ils produisent et consomment
85% des produits chimiques synthétiques, 80% de l'énergie
commerciale ou encore 40% de l'eau douce (www.environnement.gouv.fr),
leurs émissions de gaz à effet de serre sont dix fois
plus élevées que celles des pays pauvres. Les pays
émergeants du sud ont tendance à suivre cet exemple.
Lorsqu'ils parviennent à s'engager sur un sentier de
croissance économique soutenue c'est souvent au détriment
total de l'environnement ; et si beaucoup de pays du sud n'ont pas
accrus leur consommation d'énergie ou leur émission de
polluants, c'est plus par impuissance que par choix.
3ème
constat : Trop de soleil, pas assez d'eau
En
moyenne la température s'est élevée de ½
degré depuis le début du 20ème siècle, et
la présence de dioxyde de carbone a progressé de 30%
dans l'air depuis l'ère préindustrielle selon une
mission ministérielle sur l'effet de serre.
 Les
principales sources de ces gaz sont la production d'énergie
(28%), l'activité industrielle (24%), la déforestation
(24%) et les transports (16%). Comme nous l'avons dit il faudrait
réduire ces émissions de CO2 par 2 pour stabiliser les
perturbations climatiques.
Les
principales sources de ces gaz sont la production d'énergie
(28%), l'activité industrielle (24%), la déforestation
(24%) et les transports (16%). Comme nous l'avons dit il faudrait
réduire ces émissions de CO2 par 2 pour stabiliser les
perturbations climatiques.
De
plus, dans les pays en développement des régions
tropicales, 15 millions d'hectares de forêt (soit 0.3% de la
forêt mondiale) sont défrichés chaque année.
Enfin,
le problème de l'eau douce va se faire sentir. L'agriculture
emploie 70% de l'eau disponible et devrait connaître une hausse
de 40% dans les 20 prochaines années compte tenu de la
croissance démographique. D'autant plus que la moitié
des grands fleuves du monde sont fortement pollués.
Pour
résumer, Kofi ANAN, secrétaire général
des nations unies voudrait des avancés concrètes dans 5
domaines prioritaires :
L'eau
: d'ici 2025 des pays risquent d'avoir de sérieux problèmes.
L'énergie
: une condition au développement et pourtant 2 milliards de
personnes en sont privées.
La
production agricole : stopper la dégradation des sols.
Biodiversité
: gestion des écosystèmes pour préserver les
espèces (la moitié des forêts et 75% des
ressources marines ont été consommées).
La
santé : éviter les produits toxiques.
Il
existe donc un véritable défi environnemental. Face à
cela, des intellectuels ont proposé des solutions théoriques
aux problèmes environnementaux.


[
Sommaire ]
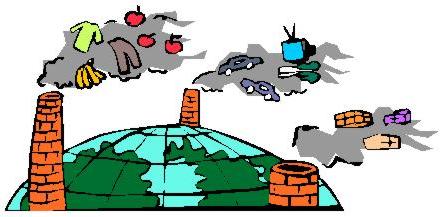 Développement
: selon la définition classique d'un dictionnaire économique,
F.PELVOUX définit le développement comme «
l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes
sociales qui permettent la croissance du produit réel global
». Il ne faut pas confondre le développement avec la
croissance économique pure et simple qui ne représente
qu'un enrichissement.
Développement
: selon la définition classique d'un dictionnaire économique,
F.PELVOUX définit le développement comme «
l'ensemble des changements des structures mentales et des habitudes
sociales qui permettent la croissance du produit réel global
». Il ne faut pas confondre le développement avec la
croissance économique pure et simple qui ne représente
qu'un enrichissement. De
plus, un problème apparaît avec l'accumulation des
déchets qui menacent les capacités d'épuration
des milieux naturels. En cela, l'approche de l'économie
écologique a le mérite d'introduire les contraintes
environnementales en analyse économique. On peut prendre
l'exemple de l'eau qui, si elle est polluée, engendre d'autres
externalités négatives pour la pêche, les
baignades, etc...
De
plus, un problème apparaît avec l'accumulation des
déchets qui menacent les capacités d'épuration
des milieux naturels. En cela, l'approche de l'économie
écologique a le mérite d'introduire les contraintes
environnementales en analyse économique. On peut prendre
l'exemple de l'eau qui, si elle est polluée, engendre d'autres
externalités négatives pour la pêche, les
baignades, etc... En
1987 les Nations Unies créent la commission sur
l'environnement et le développement, d'où émerge
le premier concept de développement durable dont l'objectif et
de satisfaire les besoins présents sans compromettre les
générations futures. Les objectifs premiers du
développement durable sont donc l'équité
inter-générationnelle et la répartition
équitable entre régions et pays du monde.
En
1987 les Nations Unies créent la commission sur
l'environnement et le développement, d'où émerge
le premier concept de développement durable dont l'objectif et
de satisfaire les besoins présents sans compromettre les
générations futures. Les objectifs premiers du
développement durable sont donc l'équité
inter-générationnelle et la répartition
équitable entre régions et pays du monde. «
Terriens, la planète fout le camp », s'est ainsi que fut
tirée la sonnette d'alarme à Rio de Janeiro, le premier
sommet de la terre en 1992, et ainsi qu'elle l'a été
régulièrement depuis, tant et si bien comme le souligne
un journaliste « d'Alternatives-économiques » que
le ressort en semble cassé : le climat qui se réchauffe,
l'eau douce qui se raréfie et 1.2 million de personne vivant
toujours avec moins de 1$ par jour .
«
Terriens, la planète fout le camp », s'est ainsi que fut
tirée la sonnette d'alarme à Rio de Janeiro, le premier
sommet de la terre en 1992, et ainsi qu'elle l'a été
régulièrement depuis, tant et si bien comme le souligne
un journaliste « d'Alternatives-économiques » que
le ressort en semble cassé : le climat qui se réchauffe,
l'eau douce qui se raréfie et 1.2 million de personne vivant
toujours avec moins de 1$ par jour .


