2
- Les solutions théoriques aux problèmes
environnementaux
Divers courants et
analyses économiques ont tenté de proposer des
solutions face à l'ampleur des dégâts causés
par les problèmes environnementaux. L'enjeux est d'importance
prépondérante, puisqu'il s'agit de la survie de
« l'espèce humaine ».
Les solutions
proposées correspondent généralement à
trois tendances : la « tradition Pigouvienne »,
le « théorème de Coase », et le
courant Ecologique.
A
- La Tradition Pigouvienne
La tradition
Pigouvienne et le théorème de Coase font tout deux
partie de l'économie néoclassique.
La théorie
néo-classique enseigne que les préférences des
individus au sein d'un marché parfait se révèlent
tel qu'elles sont satisfaites de manière optimale pour la
société. Le problème réside dans le fait
que les marchés parfaits n'ont jamais existé. Plus
particulièrement, il y a échec de marché
concernant les questions de monopoles naturels, de biens publics et
d'externalités. Le marché montre une véritable
incapacité de dévoiler les préférences en
ce qui concerne les biens publics ou collectifs. Or la plupart des
biens d'environnement sont des biens collectifs.
Un bien collectif
peut être défini par une double propriété.
Non
rivalité : le fait d'utiliser ce bien n'empêche pas les
autres de l'utiliser et ne lui enlève rien.
Non
exclusivité : il est impossible d'écarter qui que ce
soit de l'utilisation, y compris les individus ne participant pas à
son financement. Il y a une difficulté qui vient du phénomène
dit du profiteur ou « free rider ». Un
individu a pas intérêt à révéler
ce qu'il consentirai à payer pour bénéficier
d'un bien public, il lui suffit d'espérer que se seront les
autres qui en supporteront la charge financière. Ici la
vérité des prix n'existe pas, les mécanismes du
marché échouent. Il est difficile de produire des
biens collectifs.
1)
Effet externe et déséconomie externe
a
) Marshall et les effets externes
Au cours de son
analyse des rendements croissants en 1890, Alfred Marshall (1842 -
1880) dans son livre « Principes d'Economie Politique »
explique que la nature est soumise à la loi des rendements
décroissants, tandis que l'organisation industrielle engendre
des rendements croissants. Il avance la notion d'économie
externe pour démontrer cela. Ceux sont notamment les économies
d'échelle qui se manifestent au sein d'une entreprise qui
augmente son échelle de production. Constatant que ces
économies internes n'était pas suffisante pour
expliquer les rendements croissant, il introduit une autre
explication. Selon cette explication, les rendements croissants
viendraient aussi d'économies externes. Ceux sont « celles
qui résultent du progrès général de
l'environnement ». Ex: les progrès des moyens de
transport...
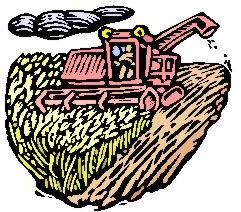 Marshall
trouvait ainsi une explication suffisante entre les rendement
décroissants dans l'agriculture et la croissance continue du
produit global par habitant. Il n'a cependant fait que constater ces
économies externes et ne les a pas évaluées,
c'est-à-dire donné un quasi prix.
Marshall
trouvait ainsi une explication suffisante entre les rendement
décroissants dans l'agriculture et la croissance continue du
produit global par habitant. Il n'a cependant fait que constater ces
économies externes et ne les a pas évaluées,
c'est-à-dire donné un quasi prix.
Aujourd'hui le
concept d'externalité est devenu extrêmement large et
souvent imprécis. On peut définir les externalités
comme les effets positifs ou négatifs qu'entraîne
l'activité d'un agent économique à l'extérieur
de cette activité ou que subi cet agent en provenance de
l'extérieur. Ceux sont des biens ou des charges extérieurs
au marché. Marshall n'a mis en évidence que les effets
extérieurs positifs, et c'est Pigou qui a mis en évidence
que les effets externes peuvent aussi être négatif.
b
) Pigou et les déséconomies externes
En 1920, Pigou
explique que la pollution est une déséconomie externe
dans la mesure où les dommages qu'elle provoque ne sont pas
directement pris en compte par le marché. Les déséconomies
externes constituent donc un coût social non compensé,
imposé à la collectivité, en-dehors de toutes
transactions volontaires.
Cette notion traduit
donc des conflits d'intérêts entre agents économiques
sans que ces conflits s'expriment directement en terme monétaire.
Les effets externes peuvent prendre quatre formes:
 Les
effets externes entre producteurs (ex: usine polluant l'eau utilisée
par une tannerie).
Les
effets externes entre producteurs (ex: usine polluant l'eau utilisée
par une tannerie).
Les
effets externes de producteur à consommateur (ex: pollution
d'un lac).
Les
effets externes de consommateurs à producteur.
Les
effets externes entre consommateurs, qui peuvent être dus à
la pollution ou aux phénomènes d'encombrement.
Pigou a proposé
de régler le problème des externalités en
internalisant les externalités, c'est-à-dire en leur
associant un quasi-prix. Ce n'est pas un vrai prix car il n'y a pas
de marché. C'est un « shadow price »).
Pour Pigou, « le seul instrument de mesure évidemment
disponible dans la vie sociale est le monnaie ».
A partir de Pigou,
la voie de l'intégration des biens d'environnement à la
théorie économique était donc ouverte. Les
économistes néo-classiques dès la fin des années
50 vont suivre les enseignements de Pigou en proposant de ramener au
moyen d'une taxe le niveau de production de l'activité
génératrice de pollution au niveau compatible avec un
optimum social de Pareto.
2)
Le principe de base des politiques anti-pollution: le principe du
pollueur payeur
Ce principe du
pollueur payeur est un principe qui fait écho à un
slogan politique: « que les pollueurs soient les
payeurs ». C'est un pur produit de l'économie
néo-classique. On est en effet ici dans le cadre néo-classique
des facteurs de production. Les ressources d'environnement (l'air,
l'eau...) constituent un facteur de production exactement au même
titre que les autres éléments entrant dans le processus
de production.
.jpg) Le
facteur de production environnement, plus précisément
la dégradation de l'environnement doit être rémunéré
au même titre que les autres facteurs. Pour que les coût
des biens et services produits reflètent la rareté
relative des ressources d'environnement, il faut donc que le pollueur
prennent en charge les coûts de ces ressources. C'est cette
règle de bon sens économique qui se trouve à la
base du principe du pollueur payeur. Le coût doit être
dans les coût de production. Le pollueur doit internaliser les
coûts de pollution. Avec cette internalisation il y a donc un
« signal prix » qui est donné et le
système économique peut réagir et s'adapter en
conséquence. C'est l'OCDE qui a défini et recommandé
depuis 1972 l'application du principe du pollueur payeur.
Le
facteur de production environnement, plus précisément
la dégradation de l'environnement doit être rémunéré
au même titre que les autres facteurs. Pour que les coût
des biens et services produits reflètent la rareté
relative des ressources d'environnement, il faut donc que le pollueur
prennent en charge les coûts de ces ressources. C'est cette
règle de bon sens économique qui se trouve à la
base du principe du pollueur payeur. Le coût doit être
dans les coût de production. Le pollueur doit internaliser les
coûts de pollution. Avec cette internalisation il y a donc un
« signal prix » qui est donné et le
système économique peut réagir et s'adapter en
conséquence. C'est l'OCDE qui a défini et recommandé
depuis 1972 l'application du principe du pollueur payeur.
« Ce
principe signifie que le pollueur devrait se voir imputer les
dépenses relatives aux mesures arrêtées par les
pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état
acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait
être répercuté dans le coût des biens et
services qui sont à l'origine de la pollution du fait de leur
production et/ou de leur consommation. »
OCDE,
"Le principe du Pollueur Payeur, Définition, analyse,
mise en Suvre".
De là on peut
remarquer :
Le
principe du pollueur payeur n'implique pas forcément la prise
en charge des coûts par le pollueur. Le pollueur peut
répercuter ses coûts de production dans ses prix de
ventes. On devrait plutôt parler de principe pollueur premier
payeur.
C'est
au pouvoir public de déterminer qui est le pollueur, donc le
payeur.
Le
pollueur devra payer ce que les pouvoir public lui demande (normes,
taxes, dédommagements...).
Le
principe du pollueur payeur n'est pas un principe d'optimisation car
n'implique pas obligatoirement une diminution de la pollution à
un niveau optimal.
Le
principe du pollueur payeur n'est pas un principe général
d'internalisation parce que les coûts de l'environnement
peuvent aussi être internalisé au moyen de subventions
ou de prime versé au pollueur.
Au total le principe
du pollueur payeur constitue un principe général
d'allocation des coûts d'environnement. Il a été
adopté comme principe de base des politiques d'environnement
par les pays de l'OCDE.
Il y a une nécessité
d'adopter un principe commun parce que si chaque pays applique une
politique différente il y aura forcément des
distorsions et donc conflit en matière de commerce
international.
Mais le principe du
pollueur payeur n'a pas satisfait tout les auteurs néo-classiques.
Coase propose une autre approche.
B
- Le « Théorème de Coase »
Ronald Coase est
célèbre pour deux articles: « la nature de
la firme » (Economica; 1937) et « le problème
du coût social » (Journal of law and economic;
Octobre 1960). Dans le premier article Coase invente le concept de
coût de transaction. Dans le second il remet en question la
tradition pigouvienne d'internalisation des externalités à
partir d'une approche en terme de droit de propriétés.
1)
La notion de coût de transaction
 En
1937, Ronald Coase pose des questions: pourquoi y a-t-il des firmes
plutôt que pas de firmes ? Pourquoi n'y a-t-il pas que des
petites entrepreneurs individuels ? Pour répondre Coase
introduit la notion de coûts de transaction. Par ce terme, il
faut entendre l'ensemble des coûts liés à la
mesure des échanges (coûts de négociation, coût
de transaction des prix...) ainsi que ceux lié au droit de
propriété (coût d'un avocat, coût d'un
expert...). Ceux sont donc les coût d'accès au système
de prix (alors que dans la théorie néo-classique, les
coûts d'accès au système de prix sont nuls).
En
1937, Ronald Coase pose des questions: pourquoi y a-t-il des firmes
plutôt que pas de firmes ? Pourquoi n'y a-t-il pas que des
petites entrepreneurs individuels ? Pour répondre Coase
introduit la notion de coûts de transaction. Par ce terme, il
faut entendre l'ensemble des coûts liés à la
mesure des échanges (coûts de négociation, coût
de transaction des prix...) ainsi que ceux lié au droit de
propriété (coût d'un avocat, coût d'un
expert...). Ceux sont donc les coût d'accès au système
de prix (alors que dans la théorie néo-classique, les
coûts d'accès au système de prix sont nuls).
Avec ce concept
Coase peut répondre à ses questions de départ :
il y a des firmes parce que les coûts de transaction (les coûts
d'accès au système de prix sur le marché
externe) sont supérieurs pour l'obtention du même bien
et du même service aux coûts d'organisations internes des
firmes. (Mais comment les évaluer ? Coase ne propose rien!).
2)
La mise en cause de la tradition pigouvienne
Pour Ronald Coase,
les problèmes d'environnement trouvent leur origine non pas
dans de prétendues défauts du marché mais dans
de réels défauts de droits de propriété.
En l'absence d'une définition stricte de ces droits, la
pollution a pour caractéristique un caractère
réciproque: le pollueur a autant le droit de polluer que le
pollué le droit de ne pas être pollué.
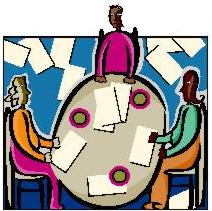 Il
n'est pas pertinent de s'interroger comme le fait Pigou en terme de
différence entre coût privés et coût social
(cette différence devant être chez Pigou internalisé
au moyen de la taxe). Pour Coase le critère pertinent pour
apprécier la solution à apporter à un effet
externe réside dans la maximisation de la valeur du produit
collectif : seule l'efficience de la solution proposée importe
et non son caractère équitable. Le choix de la solution
la plus efficiente va dépendre chez Coase de la comparaison
coût de transaction/coût d'organisation de
l'administration. Cette comparaison a pour cadre le théorème
de Coase: après une définition des droits de propriété
sur l'environnement et en l'absence de coût de transaction, il
y a un intérêt économique à ce que qu'une
négociation s'instaure directement entre pollueur et victime
de la pollution (=> dans un monde où les coût de
transaction sont nulles et les droits de propriétés
bien définis), il est possible d'obtenir une allocation
optimale des ressources sans intervention de l'état). Dans le
monde réel les coûts de transaction sont toujours
positifs, et Ronald Coase dégage deux cas possibles pour
atteindre l'efficience à partir de la comparaison entre les
coûts de transaction et les coûts d'organisation de
l'administration :
Il
n'est pas pertinent de s'interroger comme le fait Pigou en terme de
différence entre coût privés et coût social
(cette différence devant être chez Pigou internalisé
au moyen de la taxe). Pour Coase le critère pertinent pour
apprécier la solution à apporter à un effet
externe réside dans la maximisation de la valeur du produit
collectif : seule l'efficience de la solution proposée importe
et non son caractère équitable. Le choix de la solution
la plus efficiente va dépendre chez Coase de la comparaison
coût de transaction/coût d'organisation de
l'administration. Cette comparaison a pour cadre le théorème
de Coase: après une définition des droits de propriété
sur l'environnement et en l'absence de coût de transaction, il
y a un intérêt économique à ce que qu'une
négociation s'instaure directement entre pollueur et victime
de la pollution (=> dans un monde où les coût de
transaction sont nulles et les droits de propriétés
bien définis), il est possible d'obtenir une allocation
optimale des ressources sans intervention de l'état). Dans le
monde réel les coûts de transaction sont toujours
positifs, et Ronald Coase dégage deux cas possibles pour
atteindre l'efficience à partir de la comparaison entre les
coûts de transaction et les coûts d'organisation de
l'administration :
Les
coût de transaction (pour marchandiser la pollution entre
pollueur et pollués) sont inférieurs aux coûts
d'organisation de l'administration (pour définir le pollueur,
évaluer monétairement le coût social, pour
prélever la taxe et contrôler son application). Dans ce
cas il faut laisser faire le marché et les externalités
disparaîtront au terme de la négociation des agents.
Les
coûts de transaction sont supérieurs aux coûts
d'organisation de l'administration. Dans ce cas l'état doit
intervenir, y compris sous forme réglementaire.
3)
Théorème de Coase et droits de propriété
Selon Ronald Coase,
le simple établissement de droits de propriété
(donc sans taxe fixée par l'état) devrait permettre la
réalisation d'un optimum. Un droit de propriété
donne le droit d'utiliser une ressource. Si les pollués
disposent du droit de propriété, il disposent du droit
de ne pas être pollué. Si les droits de propriété
sont conférés à la firme polluante, elle a le
droit de polluer.
 Il
y a deux possibilités concernant les droits de propriété:
Il
y a deux possibilités concernant les droits de propriété:
Les
pollués obtiennent le droit de propriété. Dans
ce cas le pollueur doit soit épuré soit racheté
des droits de propriété (c'est-à-dire des
droits à polluer).
La
firme obtient les droits de propriété (elle a le droit
de polluer). Dans ce cas ce sont les pollués qui vont offrir
des compensations à la firme pour qu'elle réduise son
activité.
L'intervention de
l'état est donc inutile dans la lutte contre la pollution.
C
- Le courant Economie Ecologique
A l'opposé
des idées développées par les économistes
libéraux, un mouvement écologique s'est instauré.
Il poursuit le même but que les auteurs néo-classiques :
concilier développement et environnement. Mais les moyens
qu'il propose diffèrent des solutions théoriques déjà
proposées.
1)
La bio-économie : les positions radicales de
Georgescu-Roegen
Selon Nicholas
Georgescu-Roegen, la bio économie conçoit le processus
économique comme une extension de l'évolution
biologique. Elle se présente en trois points :
a
) Georgescu-Roegen et les lois thermodynamiques
On doit à
Nicholas Georgescu-Roegen la réintroduction des aspects
physiques de la production dans le champs de vision des économies.
Il a mis en évidence les conséquences de la
thermodynamique sur le développement des sociétés
humaines.
La thermodynamique
étudie les lois de la transformation de la chaleur en travail.
Les principes sont les suivants:
Le
principe de conservation ou d'équivalence de l'énergie.
L'énergie de l'univers est constante.
Le
principe de la dégradation de l'énergie (principe de
Carnot ou loi de l'entropie). Carnot en 1824 montre qu'il y a une
perte inéluctable de la quantité de l'énergie.
Ce phénomène est appelé « entropie »
(du grec « transformation »). C'est la
diminution irréversible de l'énergie disponible pour
produire du travail. C'est une mesure de l'énergie
inutilisable dans un système thermodynamique. Elle se définie
comme une mesure du désordre. Cette loi stipule que
l'entropie d'un système clos augmente constamment ou que
l'ordre d'un tel système se transforme continuellement en
désordre.
Pour
Nicholas Georgescu-Roegen, il y a un principe de dégradation
de la matière. La matière est elle aussi soumise à
la loi de l'entropie. Donc des limites physiques que rencontrera la
croissance des sociétés industrielles résident
dans l'entropie matérielle, et pas seulement dans le
disposition énergétique.
b
) L'entropie et l'économie
Du point de vue de
la thermodynamique, la matière-énergie absorbée
par le processus économique l'est dans un état de basse
entropie et elle en sort dans un état de haute entropie. Le
processus économique d'un point de vue purement physique ne
fait que transformer des ressources naturelles de valeurs (basse
entropie) en déchets (haute entropie). Par suite de cette
destructuration de la matière et de l'énergie, les
développements économiques actuels affectent ceux qui
seront possibles aux hommes de demain.
Georgescu-Roegen
fait des propositions :
Nécessité
d'aller vers la décroissance.
Refuser
les instruments économique de gestion de l'environnement.
Le
principe de non regret et de minimisation des regrets futurs. Ce
principe correspond au principe de prudence. Il doit servir de ligne
de conduite aux activités humaines.
Retour
aux matières issus du vivant (bio masse) et chercher à
développer l'énergie solaire.
2)
La tentative de refondation économique
L'économie
écologique, selon Herman Daly en 1987, se présente
comme un champ interdisciplinaire étudiant les relations entre
systèmes socio-économiques et écosystèmes.
On y trouve un certain nombre de préceptes qui proviennent,
d'une part, de la science écologique et, d'autre part, d'une
réflexion élargie sur l'économie.
a
) Les enseignements de l'écologie
Selon les partisans
d'une « économie écologique »,
l'écologie doit fournir les bases d'une nouvelle description
analytique du processus économique. Trois aspects prédominent:
Le
point de vue holiste, propre à la science écologique,
est privilégié. L'économie écologique
entend ainsi renverser la hiérarchisation opérée
traditionnellement par les économistes qui cherchent à
internaliser la logique écologique dans la logique
économique. La relation d'inclusion qui doit être
reconnue est inverse : les systèmes socio-économiques
sont des sous-systèmes ouverts sur le système
écologique planétaire dans lequel ils doivent ménager
leur insertion. Les hypothèses de séparabilités
spatiale et temporelles qui sont attachées aux notions
« d'environnement » et de « ressources
naturelles » qu'utilise l'économie néo-classique
apparaissent en contradiction flagrante avec la réalité
de la biosphère, cette organisation hypercomplexe dont on
commence à peine à comprendre les mécanismes.
Les
systèmes socio-économiques et les systèmes
naturels sont en perpétuelle évolution. Le processus
économique (processus de « destruction/création »
selon l'expression de Schumpeter) modifie irrévocablement le
milieu naturel et, en retour, ce dernier modifie irrévocablement
le premier. Richard Norgaard en 1985 a été l'un des
premiers à souligner ce phénomène que les
écologistes appellent un phénomène de
« coévolution ». Dans le cas de
l'espèce humaine, cette continuelle interaction génératrice
d'histoire entre société et biosphère ne peut
se comprendre qu'en prenant en compte le rôle joué par
la culture S'il importe de tenir compte de la forte évolution
de la population qui devrait se stabiliser vers 2050, il importe
aussi de considérer se qu'Alfred Lotka et Nicholas
Georgescu-Roegen appellent la dimension « exosomatique »
de l'évolution de l'homme, à savoir l'importance que
revêtent les outils, la technique et, plus largement, les
modes de production dans cette dynamique. Ainsi, environ 25% de la
population mondiale vivant dans les pays industrialisés
consomme et produit 80% respectivement, des ressources et des
déchets mondiaux. C'est dans cette perspective coévolutive
qui met l'accent sur le long, voire le très long terme, que
les tenants de l'économie écologique, réunis
autour de Robert Costanza, se sont donnés pour tâche
prioritaire l'étude de la définition et des conditions
d'un développement durable.
L'étude
du « métabolisme industriel »
est aussi un aspect dominant. Comme les écosystèmes,
les systèmes socio-économiques se maintiennent et se
développent dans le temps grâce à un apport
constant de matière et d'énergie. Celles-ci ne peuvent
être créées par l'homme, qui ne peut que les
faire changer de forme. La thermodynamique est un savoir
incontournable pour appréhender ces phénomènes
de transformations énergétiques et matérielles.
L'analyse économétrique trouve là son domaine
d'application privilégié. De leur côté,
Robert Ayres et Allen Kneese ont montré la loi de la
conservation de la matière dans le processus économique
et dans les phénomènes de pollution. C'est à
cause de celle-ci, notent ces auteurs, que l'existence
d'externalités ne peut être conçue comme une
anomalie, mais au contraire comme un phénomène normal,
inhérent à la production et à la consommation,
qui prend de l'ampleur à mesure que le système
économique se développe. Plus récemment,
systématisant l'idée des « bilan-matières »
qu'il avait introduite en économie, Robert Ayres a appelé
à l'étude de ce qu'il appelle le « métabolisme
industriel » de nos sociétés, à
savoir l'études des échanges de matière et
d'énergie qui s'effectuent entre la biosphère et les
systèmes socio-économiques modernes. Celle-ci doit
permettre de mieux comprendre la façon dont les hommes
perturbent les grands cycles biogéochimiques et, ce faisant,
de cerner certaines limites biophysiques dans lesquels doivent
s'insérer les société humaines.
Mais, si les tenants
de l'économie écologique insistent beaucoup sur l'étude
du soubassement biophysique, leur conception de l'économie ne
se réduit pas pour autant à cela.
b
) Une réflexion élargie sur le savoir et les
valeurs
La (re)définition
de l'interdisciplinarité entre l'économie et l'écologie
passe aussi, selon certains auteurs, par une réflexion
approfondie sur la positivité du discours scientifique et sur
l'interaction existant entre les processus cognitifs et les processus
de prises de décision en matière d'environnement. La
plupart des problèmes d'environnement contemporains ont en
effet des caractéristiques épistémologiques
particulières qui font qu'ils n'apparaissent pas comme des
contraintes écologiques clairement définies auxquelles
doit répondre la société. Bien au contraire,
l'ignorance est présente à tous les niveaux de
l'expertise; les dommages y sont mal cernés, incertains et
difficilement évaluables; les causalités et les
responsabilités ne sont pas clairement établies; la
rationalité des acteurs, dirait Herbert Simon, y est
nécessairement limitée. Entourée d'incertitudes
et d'incessantes controverses scientifiques, la reconnaissance du
problème d'environnement est un processus complexe de
construction sociale où interfèrent les intérêts
économiques, industriels, politiques et médiatiques.
Dans ce contexte
d'« univers controversé », comme
l'appellent Jean-Charles Hourcade et Olivier Godard, les thèses
scientifiques qui s'opposent sont convoquées par les auteurs
en fonction de leurs stratégies propres, en vue de faire
adopter les règles communes qui leur seront favorables. La
« stabilisation » du problème
d'environnement à laquelle on assiste naît de cette
interférence entre l'univers cognitif et l'univers de
l'action, et les mesures prises alors ne répondent souvent
qu'imparfaitement à l'expertise (tant initiale que finale) du
problème écologique. Il importe alors que ces
« conventions d'environnement » qui en
résultent, comme les appelle Olivier Godard, ne soient, d'une
part, ni prématurées ni rigides et qu'elles préservent
l'univers des options et, d'autre part, qu'elle définissent
des objectifs clairs qui permettront aux acteurs de faire jouer leur
rationalité.
L'analyse de tels
processus prouve que les problèmes d'environnement se posent
en terme de « légitimité » avant
de l'être en termes d'efficacité. Tout débat sur
l'environnement, toute question mettant en cause la nature est
d'abord un affrontement entre différentes « visions
du monde ». Il existe en effet une pluralité de
légitimités et de « visions de la nature »
au sein de toute société humaine, occidentale ou autre,
et entre les sociétés elles-mêmes. Il existe
d'autres « sentiments de la nature », d'autres
types de légitimités, d'autres types de valeurs,
d'autres types de représentations du monde, d'autres types de
savoirs, d'autres types d'institutions que ceux qu'étudie et
véhicule l' « idéologie économique ».
Pour rendre compte
de cette pluralité, il importe de remettre en cause les
prétendues objectivité et neutralité de
l'analyse économique néoclassique. La microéconomie,
pour reprendre les termes de Claude Henry, se présente en
effet comme un « langage de négociation »,
c'est-à-dire un ensemble de critères, de règles,
de mesures, à partir desquels les différents intérêts
en présence vont pouvoir s'exprimer, s'énoncer, se
confronter et, finalement, s'harmoniser... Comme si adopter un
langage, ce n'était pas légitimer ses catégories,
ses cadres, ses références; comme si adopter un
langage, ce n'était pas déjà légitimer sa
mise en ordre du monde. Mythifiant le progrès et la
croissance, oeuvrant à ce que Habermas appelle la
« colonisation du monde vécu », lié
à ce que Latouche nomment l' « occidentalisation du
monde », la théorie néoclassique a des
présupposés idéologiques évidents
(individus libres et égaux malgré des droits de
propriété différents, marché conçu
comme un mode de régulation harmonieux...). La façon
dont celle-ci pose les problèmes (pas seulement
d'environnement d'ailleurs) n'est que l'expression d'une de ces
légitimités, d'une de ces échelles de valeurs
qui, comme le rappellent des économistes institutionnaliste
partisans de l'économie écologique comme Richard
Norgaard ou Peter Söderbaum, sous-tendent tout discours sur la
société. De plus, s'il est vrai que toute question
mettant en cause la nature est d'abord un affrontement entre
différentes « vision du monde », il est
également vrai que celui qui souvent se fait entendre a usé
d'une force et d'une qui ne sont pas que dans les paroles et dans les
mots...


[
Sommaire ]
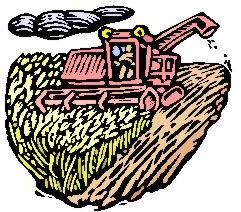 Marshall
trouvait ainsi une explication suffisante entre les rendement
décroissants dans l'agriculture et la croissance continue du
produit global par habitant. Il n'a cependant fait que constater ces
économies externes et ne les a pas évaluées,
c'est-à-dire donné un quasi prix.
Marshall
trouvait ainsi une explication suffisante entre les rendement
décroissants dans l'agriculture et la croissance continue du
produit global par habitant. Il n'a cependant fait que constater ces
économies externes et ne les a pas évaluées,
c'est-à-dire donné un quasi prix. Les
effets externes entre producteurs (ex: usine polluant l'eau utilisée
par une tannerie).
Les
effets externes entre producteurs (ex: usine polluant l'eau utilisée
par une tannerie)..jpg) Le
facteur de production environnement, plus précisément
la dégradation de l'environnement doit être rémunéré
au même titre que les autres facteurs. Pour que les coût
des biens et services produits reflètent la rareté
relative des ressources d'environnement, il faut donc que le pollueur
prennent en charge les coûts de ces ressources. C'est cette
règle de bon sens économique qui se trouve à la
base du principe du pollueur payeur. Le coût doit être
dans les coût de production. Le pollueur doit internaliser les
coûts de pollution. Avec cette internalisation il y a donc un
« signal prix » qui est donné et le
système économique peut réagir et s'adapter en
conséquence. C'est l'OCDE qui a défini et recommandé
depuis 1972 l'application du principe du pollueur payeur.
Le
facteur de production environnement, plus précisément
la dégradation de l'environnement doit être rémunéré
au même titre que les autres facteurs. Pour que les coût
des biens et services produits reflètent la rareté
relative des ressources d'environnement, il faut donc que le pollueur
prennent en charge les coûts de ces ressources. C'est cette
règle de bon sens économique qui se trouve à la
base du principe du pollueur payeur. Le coût doit être
dans les coût de production. Le pollueur doit internaliser les
coûts de pollution. Avec cette internalisation il y a donc un
« signal prix » qui est donné et le
système économique peut réagir et s'adapter en
conséquence. C'est l'OCDE qui a défini et recommandé
depuis 1972 l'application du principe du pollueur payeur. En
1937, Ronald Coase pose des questions: pourquoi y a-t-il des firmes
plutôt que pas de firmes ? Pourquoi n'y a-t-il pas que des
petites entrepreneurs individuels ? Pour répondre Coase
introduit la notion de coûts de transaction. Par ce terme, il
faut entendre l'ensemble des coûts liés à la
mesure des échanges (coûts de négociation, coût
de transaction des prix...) ainsi que ceux lié au droit de
propriété (coût d'un avocat, coût d'un
expert...). Ceux sont donc les coût d'accès au système
de prix (alors que dans la théorie néo-classique, les
coûts d'accès au système de prix sont nuls).
En
1937, Ronald Coase pose des questions: pourquoi y a-t-il des firmes
plutôt que pas de firmes ? Pourquoi n'y a-t-il pas que des
petites entrepreneurs individuels ? Pour répondre Coase
introduit la notion de coûts de transaction. Par ce terme, il
faut entendre l'ensemble des coûts liés à la
mesure des échanges (coûts de négociation, coût
de transaction des prix...) ainsi que ceux lié au droit de
propriété (coût d'un avocat, coût d'un
expert...). Ceux sont donc les coût d'accès au système
de prix (alors que dans la théorie néo-classique, les
coûts d'accès au système de prix sont nuls).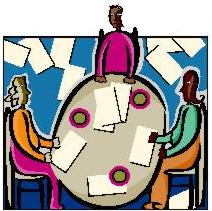 Il
n'est pas pertinent de s'interroger comme le fait Pigou en terme de
différence entre coût privés et coût social
(cette différence devant être chez Pigou internalisé
au moyen de la taxe). Pour Coase le critère pertinent pour
apprécier la solution à apporter à un effet
externe réside dans la maximisation de la valeur du produit
collectif : seule l'efficience de la solution proposée importe
et non son caractère équitable. Le choix de la solution
la plus efficiente va dépendre chez Coase de la comparaison
coût de transaction/coût d'organisation de
l'administration. Cette comparaison a pour cadre le théorème
de Coase: après une définition des droits de propriété
sur l'environnement et en l'absence de coût de transaction, il
y a un intérêt économique à ce que qu'une
négociation s'instaure directement entre pollueur et victime
de la pollution (=> dans un monde où les coût de
transaction sont nulles et les droits de propriétés
bien définis), il est possible d'obtenir une allocation
optimale des ressources sans intervention de l'état). Dans le
monde réel les coûts de transaction sont toujours
positifs, et Ronald Coase dégage deux cas possibles pour
atteindre l'efficience à partir de la comparaison entre les
coûts de transaction et les coûts d'organisation de
l'administration :
Il
n'est pas pertinent de s'interroger comme le fait Pigou en terme de
différence entre coût privés et coût social
(cette différence devant être chez Pigou internalisé
au moyen de la taxe). Pour Coase le critère pertinent pour
apprécier la solution à apporter à un effet
externe réside dans la maximisation de la valeur du produit
collectif : seule l'efficience de la solution proposée importe
et non son caractère équitable. Le choix de la solution
la plus efficiente va dépendre chez Coase de la comparaison
coût de transaction/coût d'organisation de
l'administration. Cette comparaison a pour cadre le théorème
de Coase: après une définition des droits de propriété
sur l'environnement et en l'absence de coût de transaction, il
y a un intérêt économique à ce que qu'une
négociation s'instaure directement entre pollueur et victime
de la pollution (=> dans un monde où les coût de
transaction sont nulles et les droits de propriétés
bien définis), il est possible d'obtenir une allocation
optimale des ressources sans intervention de l'état). Dans le
monde réel les coûts de transaction sont toujours
positifs, et Ronald Coase dégage deux cas possibles pour
atteindre l'efficience à partir de la comparaison entre les
coûts de transaction et les coûts d'organisation de
l'administration : Il
y a deux possibilités concernant les droits de propriété:
Il
y a deux possibilités concernant les droits de propriété: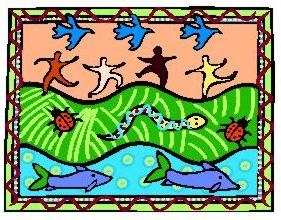 Nous
sommes une espèce biologique comme toute les espèces
terrestres.
Nous
sommes une espèce biologique comme toute les espèces
terrestres.
