3
- Les solutions actuelles existantes
La problématique
relation entre développement et environnement est un défi
à l'échelle planétaire. A travers l'Histoire, on
constate (tragiquement) que majoritairement les individus livrés
à eux-même ne prennent pas à coeur la
préservation de leur environnement naturel. Pour palier à
cela, l'institution étatique en place doit mener des actions
qui assurent une sauvegarde du milieu naturel. Cependant, face à
l'ampleur des dégâts et à leur portée, les
états seuls ne peuvent pas tout résoudre. Les problèmes
ne se limitent pas aux frontières. C'est pourquoi une
coopération internationale au niveau des action
environnementale est jugée plus que nécessaire.
Les états se battent
donc pour conserver et protéger la nature, mais ils ne sont
pas seuls. Non seulement une entraide mondiale se met en place mais
de plus des nombreuses organisations dépassant parfois le
simple cadre national luttent aussi pour maintenir un cadre de vie
sain.
A
- Au niveau national
Pour intervenir, les états
doivent connaître les objectifs qu'ils se fixent. Il leur faut
donc des indicateurs sur lesquels ils peuvent baser leur politique.
Ces indicateurs sont prépondérants car d'eux dépend
la crédibilité de l'intervention étatique. Ils
doivent donc être le plus précis possible pour apporter
le maximum d'informations sur les conditions environnementales. En
effet, le développement a des conséquences sur
l'environnement. Pour mesurer cet impact et les externalités
qui en découlent, ces indicateurs sont de précieux
auxiliaires. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance des
informations que fournissent ces indicateurs que les gouvernements
peuvent agir.
1)
Les indicateurs
De même que le carnet
de notes fournit une mesure des progrès réalisés
par le élève dans les différentes discipline, de
même les gouvernements et les citoyens ont besoin d'indicateurs
pour mesurer l'évolution vers les objectifs de société
qu'ils se sont fixés.
a
) Le Produit National Brut
L'indicateur qui est
aujourd'hui communément utilisé est le produit national
brut (PNB). Le PNB est la mesure de la production totale des biens et
des services d'une économie. Il est le critère de base
employé pour évaluer la richesse d'un pays. Presque
partout on considère qu'une hausse du PNB signifie que la
santé du pays s'améliore et donc que ses habitants
vivent mieux. Toutefois, si on examine de plus près le système
comptable employé pour calculer le PNB, on constate qu'il
présente d'importantes lacunes dans l'évaluation du
développement à long terme. La comptabilité
économique nationale comprend d'une part des comptes de
recettes qui, lorsqu'on les totalise, donnent le PNB, et d'autre part
des comptes de capital qui enregistrent les variations de la
richesse. A mesure que vieillisse et tombent en désuétude
les installations de transformation du bois, les usines textiles, les
immeubles et autres infrastructures, une partie de leur valeur est
déduite des comptes de capital de manière à
prendre en considération cette dépréciation.
Toutefois, aucune déduction similaire n'est opérée
pour tenir compte de la dégradation des forêts, des
sols, de la qualité de l'air et autres dotations naturelles.
On rogne sur les richesse naturelles de toutes sortes sans en
enregistrer la dépréciation dans les comptes de la
nation.
 Ainsi,
lorsque les arbres sont abattus et vendus comme bois d'oeuvre, le
produit est comptabilisé comme recette, et donc ajouté
au PNB. Mais aucun débit correspondant à la dégradation
de la forêt n'est enregistré. Pourtant, si cette
ressources économique est bien gérée, elle
pourrait générer des revenus à long terme. Il en
résulte un sens exagéré de l'importance des
revenus et des richesses, ce qui créé une illusion que
le pays est dans une situation meilleure qu'il ne l'est en réalité
et qu'il peut supporter des niveaux de consommation plus élevés
qu'il n'est véritablement en mesure de la faire. R. Repetto,
économiste à l'Institut mondial des ressources, note
qu'en raison de cette incapacité à distinguer la
destruction de l'actif naturel de la production de revenus, le PNB
est comme un « phare trompeur, capable d'attirer sur les
rochers ceux qui passent à proximité ».
Ainsi,
lorsque les arbres sont abattus et vendus comme bois d'oeuvre, le
produit est comptabilisé comme recette, et donc ajouté
au PNB. Mais aucun débit correspondant à la dégradation
de la forêt n'est enregistré. Pourtant, si cette
ressources économique est bien gérée, elle
pourrait générer des revenus à long terme. Il en
résulte un sens exagéré de l'importance des
revenus et des richesses, ce qui créé une illusion que
le pays est dans une situation meilleure qu'il ne l'est en réalité
et qu'il peut supporter des niveaux de consommation plus élevés
qu'il n'est véritablement en mesure de la faire. R. Repetto,
économiste à l'Institut mondial des ressources, note
qu'en raison de cette incapacité à distinguer la
destruction de l'actif naturel de la production de revenus, le PNB
est comme un « phare trompeur, capable d'attirer sur les
rochers ceux qui passent à proximité ».
Les pays en voie de
développement, dont les économies sont encore
étroitement dépendantes des matières premières
(combustibles, bois, minéraux, agriculture) sont les plus
menacés d'échouages. La Bolivie, la Colombie,
l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria figurent parmi ceux dont
au moins 75% des exportations sont composées de matières
premières.
 Le
PNB, calculé comme il l'est aujourd'hui, est non seulement
aveugle à la destruction des richesses naturelles, mais il
présentent aussi un autre grand défaut : il
comptabilise comme recette nombre de dépenses effectuées
pour combattre la pollution et leur conséquences néfastes.
La marée noire
de Mars 1989 en Alaska qui, de toute l'histoire des
Etats-Unis, a été probablement l'accident le plus
dommageable pour les milieux naturels, a entraîné une
augmentation du PNB, puisque la majeure partie des 2,2 milliards de
dollars dépensés en main-d'oeuvre et en équipements
dans le cadre des opérations de nettoyage a été
ajoutée aux recettes. Tout aussi pervers est l'enregistrement
dans les recettes de la comptabilité nationale des soins
médicaux induits par la pollution atmosphérique,
englobés dans des dizaines de milliards de dollars dépensés
par les américains pour leur frais de santé.
Le
PNB, calculé comme il l'est aujourd'hui, est non seulement
aveugle à la destruction des richesses naturelles, mais il
présentent aussi un autre grand défaut : il
comptabilise comme recette nombre de dépenses effectuées
pour combattre la pollution et leur conséquences néfastes.
La marée noire
de Mars 1989 en Alaska qui, de toute l'histoire des
Etats-Unis, a été probablement l'accident le plus
dommageable pour les milieux naturels, a entraîné une
augmentation du PNB, puisque la majeure partie des 2,2 milliards de
dollars dépensés en main-d'oeuvre et en équipements
dans le cadre des opérations de nettoyage a été
ajoutée aux recettes. Tout aussi pervers est l'enregistrement
dans les recettes de la comptabilité nationale des soins
médicaux induits par la pollution atmosphérique,
englobés dans des dizaines de milliards de dollars dépensés
par les américains pour leur frais de santé.
 Le
pays aurait certainement été plus riche si la marée
noire de l'Alaska n'avait pas eu lieu et si personne ne souffrait de
maladie respiratoires dues à la pollution
de l'air, mais le PNB laisse à penser qu'il en est
autrement. Selon F. Bracho, du South Commission Office, cet
indicateur « est un ensemble indifférencié
qui attribue une valeur positive à toute activité
économique, qu'elle soit productive, improductive ou
destructrice ».
Le
pays aurait certainement été plus riche si la marée
noire de l'Alaska n'avait pas eu lieu et si personne ne souffrait de
maladie respiratoires dues à la pollution
de l'air, mais le PNB laisse à penser qu'il en est
autrement. Selon F. Bracho, du South Commission Office, cet
indicateur « est un ensemble indifférencié
qui attribue une valeur positive à toute activité
économique, qu'elle soit productive, improductive ou
destructrice ».
A mesure que s'accélère
la dégradation de l'environnement, l'écart s'élargie
entre l'évaluation des progrès en terme de PNB et la
réalité des conditions de vie des populations. De fait,
le PNB devient une mesure obsolète du progrès dans une
société qui s'efforce de satisfaire les besoins des
gens aussi efficacement que possible tout en minimisant la
dégradation de l'environnement. Ce qui compte, ce n'est pas
l'accroissement de la production, mais la qualité des services
rendus. Ainsi, la bicyclette et les trains d'intérêt
local sont des formes de transport qui consomment proportionnellement
moins de ressources et contribuent moins au PNB que les automobiles.
 Pourtant,
l'utilisation plus fréquente des transports en commun et de la
bicyclette pour la plupart des déplacement améliorerait
la qualité de la vie urbaine, en éliminant les
embouteillages et en rendant les villes plus sûres pour les
piétons. Selon G. Hardin, écologiste et philosophe,
« s'efforcer de maximiser le PNB est à peu près
aussi sensé de la part d'un homme d'état que, pour un
compositeur, de chercher à mettre le plus de notes possible
dans uns symphonie ».
Pourtant,
l'utilisation plus fréquente des transports en commun et de la
bicyclette pour la plupart des déplacement améliorerait
la qualité de la vie urbaine, en éliminant les
embouteillages et en rendant les villes plus sûres pour les
piétons. Selon G. Hardin, écologiste et philosophe,
« s'efforcer de maximiser le PNB est à peu près
aussi sensé de la part d'un homme d'état que, pour un
compositeur, de chercher à mettre le plus de notes possible
dans uns symphonie ».
Pour combler l'écart
croissant entre les gains économiques réels et
illusoires, un premier pas essentiel consiste à définir
une nouvelle façon de calculer le PNB, afin qu'il tienne
compte de l'amenuisement et de la dégradation des forêts,
des pêcheries et des réserves en eau, de la qualité
de l'air et des autres ressources naturelles. Plusieurs initiatives
ont été prises en ce sens. L'Australie, le Canada, la
France, les Pays-Bas et la Norvège sont parmi les pays ayant
entrepris un inventaire de leurs ressources naturelles, ce qui
constitue un préalable aux ajustements comptables nécessaires.
Cependant, tant que les méthodes utilisées
traditionnellement pour calculer le PNB seront jugées
acceptables, aucune amélioration d'envergure en terme de
fiabilité ne sera possible.
b
) L'Indicateur de Développement Humain
D'autres indicateurs
fournissent des information concernant l'environnement. Ainsi
l'Indicateur composite de Développement Humain (IDH) (carte
mondiale; classement) a été
conçu en 1990 par le programme des Nations Unies pour le
développement. L'IDH, évalué selon une échelle
allant de 0 à 1, est l'agrégat de trois indicateurs :
la longévité, l'instruction et la maîtrise des
ressources nécessaires à une vie décente. Pour
évaluer la longévité, l'équipe de l'ONU
se sert de l'espérance de vie à la naissance. Pour
l'instruction, elle se réfère à
l'alphabétisation des adultes et au nombre moyen d'années
d'école. Enfin, pour la maîtrise des ressources, elle a
recours au produit intérieur brut (PIB) par habitant, après
correction compte tenu du pouvoir d'achat. Parce que ces indicateurs
sont des moyennes nationales, ils ne prennent pas en compte
directement les inégalités de répartition des
richesses mais, par contre, en incluant longévité et
alphabétisation, ils reflètent indirectement la
distribution des ressources. Ainsi, une grande espérance de
vie implique un large accès aux soins médicaux, une
nourriture suffisante et de l'eau potable en quantités
suffisantes.
 L'IDH
évolue sans cesse ; en effet, dans certains cas, en raison des
perfectionnement apportés par l'équipe de l'ONU, le
classement connaît de notable différences d'une année
à l'autre. A mesure que de nouvelles données seront
disponibles, l'IDH en viendra à prendre en compte d'autres
facteurs de développement humain. Ainsi il existe suffisamment
d'informations pour inclure les inégalités entre les
sexes dans l'IDH. De la même manière, le classement
change quand on tient compte de la répartition des revenus.
L'IDH
évolue sans cesse ; en effet, dans certains cas, en raison des
perfectionnement apportés par l'équipe de l'ONU, le
classement connaît de notable différences d'une année
à l'autre. A mesure que de nouvelles données seront
disponibles, l'IDH en viendra à prendre en compte d'autres
facteurs de développement humain. Ainsi il existe suffisamment
d'informations pour inclure les inégalités entre les
sexes dans l'IDH. De la même manière, le classement
change quand on tient compte de la répartition des revenus.
Si, dans l'évaluation
de la qualité de vie, l'IDH représente une nette
amélioration par rapport aux méthodes fondées
sur les revenus, il ne rend pas compte actuellement de la dégradation
de l'environnement. Par conséquent, l'IDH peut fort bien
augmenter grâce à une amélioration dans le
domaine de l'alphabétisation, du pouvoir d'achat ou de la
longévité financée par l'épuisement des
ressources naturelles, ce qui prépare la détérioration
à terme des conditions de vie.
c
) Index of Sustainable Economic Welfare
En revanche, l'Index of
Sustainable Economic Welfare (ISEW) est un indicateur plus complet
des conditions des vie. Il a été mis au point par
l'économiste Hermann Dally et le théologien John Cobb.
L'ISEW reflète non seulement la consommation moyenne, mais
aussi la répartition et la dégradation l'environnement.
Après une correction du facteur consommation de l'indicateur,
de façon à tenir compte des inégalités de
répartition, les auteurs intègrent plusieurs facteurs
écologiques, comme la diminution des ressources non
renouvelables, la perte de surface cultivable due à l'érosion
des sols et à l'urbanisation, la disparition des marais et le
coût de la pollution de l'air et de l'eau. Ils incorporent
également ce qu'ils appellent les « dégradations
écologiques à long terme », facteur qui
essaie de tenir compte des changements de grandes envergure, comme
les conséquences du réchauffement du globe et des
atteintes portées à la couche d'ozone.
 La
principale faiblesse de l'ISEW est qu'il exige des informations que
seul quelques pays peuvent fournir. Ainsi, rares sont les pays en
voie de développement disposant de données exhaustives
relatives à l'étendue de la pollution de l'air et de
l'eau et, à plus forte raison, à leurs variations
annuelles.
La
principale faiblesse de l'ISEW est qu'il exige des informations que
seul quelques pays peuvent fournir. Ainsi, rares sont les pays en
voie de développement disposant de données exhaustives
relatives à l'étendue de la pollution de l'air et de
l'eau et, à plus forte raison, à leurs variations
annuelles.
En fin de compte,
l'indicateur idéal semble insaisissable. L'économiste
H. Henderson constate: « Seuls les indicateurs
transparents et concrets, que les gens peuvent facilement comprendre
et imaginer et qui ont un rapport avec leur propre vie, trouveront le
soutien politique indispensable à la mise en Suvre des
politiques gouvernementales nécessaires ». La
pertinence d'un indicateur dépend autant de la manière
dont il est employé que de la façon dont il est
composé. De nouveaux indicateurs, qui s'attachent aux critères
de viabilité, n'auront de valeur que s'ils sont rendus publics
et utilisés tant par des groupes de citoyens que par les
médias, les gouvernements et les agences de développements.
Si, donc, les taux de
déforestation, d'émission de carbone, la fréquence
des maladies et des décès dus à l'absorption
d'une eau non potable ainsi que d'autres mesures des conditions de
vie étaient publiés de manière plus régulière,
notre capacité à évaluer notre qualité de
vie s'améliorerait considérablement. Qui plus est, nous
disposerions des informations nécessaires pour mieux définir
les priorités en matière d'action politique et de
changement social.
Une fois les informations
concernant l'environnement recueillis, les états peuvent
passer à l'acte.
2)
L'état en action
a
) Sur le plan politique
Dans la majorité des
pays, la politique gouvernementale consiste en un véritable
labyrinthe d'incitations et de freins qui visent à atteindre
certains objectifs (économiques, sociaux ou politiques).
Malheureusement, et de manière plutôt surprenante, bien
des initiatives gouvernementales vont carrément à
l'encontre de la survie planétaire. Les subsides accordés
pour la construction de routes, les réglementation inéquitable
régissant le secteur public, les services d'irrigations
obtenus à des prix sous-évalués et la vente de
bois de construction à des prix inférieurs au prix
coûtant, ne sont que quelques exemples des nombreux programmes
publics susceptibles de nuire à l'environnement. A eux tous,
les gouvernements dépensent chaque années des milliards
de dollars pour soutenir des pratiques économiques néfastes
pour l'environnement.
 L'exemple
le plus courant concerne les subventions encourageant l'utilisation
des pesticides, sous différentes formes (dispenses
d'impôts...). En maintenant le prix des pesticides à un
niveau bas, les gouvernements cherchent à aider les
agriculteurs à limiter les dommages causés par les
prédateurs et à augmenter ainsi le rendement des
cultures. Mais cette pratique encourage du même coup une
utilisation excessive de ces produits, ce qui augmente le nombre de
décès et de maladies lié aux agents chimiques et
provoquent le déversement de quantités croissantes de
substances polluantes dans l'environnement. Qui plus est, ces
subventions freinent le développement et la mise en pratique
d'une gestion intégrée des prédateurs (recours
aux ennemis naturels des prédateurs, à une organisation
différente des récoltes, à des variétés
résistantes aux prédateurs et à d'autres moyens
de contrôle non chimiques permettant de stabiliser et même
d'augmenter les récoltes tout en minimisant les menaces pour
la santé et l'environnement).
L'exemple
le plus courant concerne les subventions encourageant l'utilisation
des pesticides, sous différentes formes (dispenses
d'impôts...). En maintenant le prix des pesticides à un
niveau bas, les gouvernements cherchent à aider les
agriculteurs à limiter les dommages causés par les
prédateurs et à augmenter ainsi le rendement des
cultures. Mais cette pratique encourage du même coup une
utilisation excessive de ces produits, ce qui augmente le nombre de
décès et de maladies lié aux agents chimiques et
provoquent le déversement de quantités croissantes de
substances polluantes dans l'environnement. Qui plus est, ces
subventions freinent le développement et la mise en pratique
d'une gestion intégrée des prédateurs (recours
aux ennemis naturels des prédateurs, à une organisation
différente des récoltes, à des variétés
résistantes aux prédateurs et à d'autres moyens
de contrôle non chimiques permettant de stabiliser et même
d'augmenter les récoltes tout en minimisant les menaces pour
la santé et l'environnement).
C'est pourquoi certains
états réagissent en limitant les subventions. Ainsi on
remarque que la déforestation du Brésil s'est ralentie
depuis 1988 avec les actions limitatives concernant les subventions
étatiques, mis en place par le président José
Sarney et le gouvernement de Fernando Collor de Mello. Outre les
avantages écologiques immédiats qu'elle procure, la
réduction de ces subventions atténue souvent
l'inégalité sociale et libère des fonds qui
peuvent alors servir à la mise en Suvre de programmes
bénéficiant aux pauvres. Les allocations encore versées
actuellement enrichissent souvent ceux, relativement prospères,
qui détiennent un pouvoir politique important et qui sont en
mesure d'exercer les pressions nécessaires pour obtenir des
privilèges économiques. Ainsi, les subventions pour
favoriser l'emploi de pesticides et l'irrigation ne sont d'aucun
secours pour l'agriculteur en région semi-aride, qui manque
d'argent liquide et n'a pas accès à ces subsides.
 Les
états ont un rôles essentiel a joué dans la
protection de l'environnement. En théorie, les institutions
nationales ont le recule nécessaire et les moyens de préserver
l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas des individus qui
maximisent leur utilité. Mais en pratique, il s'avère
malheureusement que certains gouvernements poursuivent des intérêts
dictés par une poignée d'individus qui ne cherche pas à
protéger le capital environnemental. Toutefois, depuis près
d'un demi siècle, on constate une prise de conscience général
des enjeux de l'environnement. Les états se sont mobilisés
pour sauvegarder leur milieu naturel.
Les
états ont un rôles essentiel a joué dans la
protection de l'environnement. En théorie, les institutions
nationales ont le recule nécessaire et les moyens de préserver
l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas des individus qui
maximisent leur utilité. Mais en pratique, il s'avère
malheureusement que certains gouvernements poursuivent des intérêts
dictés par une poignée d'individus qui ne cherche pas à
protéger le capital environnemental. Toutefois, depuis près
d'un demi siècle, on constate une prise de conscience général
des enjeux de l'environnement. Les états se sont mobilisés
pour sauvegarder leur milieu naturel.
C'est à travers les
politiques de l'environnement que les états sont passés
à l'acte. L'une des premières actions concrètes
est la mise en place d'outils fiscaux. Ces outils sont liés au
principe de pollueur payeur. Ce principe n'est pas défini
comme une principe d'allocation optimale. Ce n'est pas non plus un
principe d'équité, ni un principe de responsabilité
civile car l'identification du pollueur peut se faire de diverses
manières n'aboutissant pas toujours aux mêmes résultats.
Ce n'est pas, enfin, une principe d'internalisation totale. Ce
principe, préconisé par l'OCDE, peut être défini
ainsi : les loueurs doivent se voir imputer les dépenses
relatives aux mesures prises par les pouvoirs publics afin de
conserver l'environnement dans un état acceptable. Il s'agit
donc de répercuter les coûts des mesures de protection
dans les coûts des biens et services qui sont à
l'origine de la pollution. Pour cela, il existe plusieurs outils de
la fiscalité environnementale.
En premier lieu, des
redevances peuvent être appliquées. Une redevance est
une taxe perçue sur chaque unité de pollution déversée.
Elle est donc censée être proportionnelle à la
quantité de pollution déversée ou au dommage
causé par cette pollution. Le fondement d'une redevance peut
être incitatif (incitation au respect de l'environnement) ou
financier (collecte de fonds). L'impact de la redevance est ainsi,
soit incitatif, soit redistributif. On peut trouver des redevances
ayant à la fois une fonction incitative et un effet financier.
L'OCDE distingue quatre types de redevances:
Les
redevances de déversements. Elles sont prélevées
sur des rejets polluants déversés dans
l'environnement. On les trouve principalement dans les domaines de
l'eau et du bruit. Ainsi, l'utilisation de l'eau en France est
soumise, parallèlement à la redevance sur la
consommation, à une redevance de pollution, qui sert à
financer des aides pour la construction de réseaux et
stations d'épuration (programme pollution) et des
infrastructures concernant l'appauvrissement en eau et la qualité
de la ressource brute (programme ressource).
Les
redevances pour services rendus. Elles sont perçues pour
financer le traitement collectif ou public des rejets. On les trouve
fréquemment dans le domaine de la collecte et du traitement
des déchets. Le second type de redevance perçue sur
l'utilisation d'eau en France, la redevance sur la consommation,
entre dans cette catégorie.
Les
redevances sur les produits. Elles sont intégrées au
prix des produits polluants, soit au stade de la fabrication, soit
au stade de l'utilisation (dans le domaine pétrochimique
notamment). Elles s'appliquent sur des produits jugés
polluants au stade de la production ou de la consommation. Elles
peuvent, de plus, être assises sur certaines caractéristiques
de fabrication. Ainsi, en Norvège, une redevance sur les
huiles minérales comprend deux partie: une taxe forfaitaire
et une taxe calculée sur la teneur en souffre des huiles.
Comme les redevances sur services rendus ou de déversement,
les redevances sur produit peuvent avoir un objectif incitatif et/ou
un objectif de financement. Le premier est atteint si le montant de
la taxe suffire à dissuader l'utilisateur. Mais la plupart
des redevances sur produit utilisées en Europe ont surtout un
objectif financier.
Les
redevances administratives. Elles ont une fonction surtout
financière. Ce sont les droits de permis et/ou les
autorisations ou de contrôle. Les permis de pêche entre
dans cette catégorie.
De manière
complémentaire aux redevances, il faut citer la
différenciation par l'impôt. Elle se traduit par une
taxation différenciée selon l'utilisation de produits
ayant des caractères plus ou moins polluants. Cette
différenciation a un caractère incitatif. On la trouve,
par exemple, dans le domaine de l'essence, où une
différenciation a été introduite entre essence
sans plomb et essence « normale ». Remarquons
toutefois que dans de nombreux cas, cette différenciation par
l'impôt s'apparente davantage à une aide financière
puisqu'il s'agit d'une diminution de l'impôt a posteriori
instituée pour favoriser l'utilisation de certains produits.
La fonction de la redevance
est par conséquent double: elle incite et redistribue. Pour
être efficace sur le plan incitatif, une redevance doit être
assortie d'un taux suffisamment élevé pour que
l'objectif environnemental soit atteint. Or l'effet inflationniste
que peuvent avoir les redevances freine considérablement les
décisions dans ce domaine. La crainte d'une moindre croissance
et d'une augmentation du chômage est souvent avancée
pour justifier la prudence, ce qui empêche d'imposer des
redevance efficaces. C'est pourquoi, dans de nombreux cas,
l'efficacité des redevances sur le plan incitatif est faible.
Certaines redevances calculées pour avoir une fonction
incitative ont pour unique effet la collecte de fonds, ce qui a pour
conséquence qu'elles restent sans effets sur l'amélioration
réelle de l'environnement. Concernant la fonction de
redistribution, qui est de type financier, elle représente un
complément indispensable lorsque l'efficacité de la
redevance n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif. Le produit
des redevances de redistribution peut être utilisé pour
financer une amélioration de l'environnement ou encore des
aides financières. Le redevance de redistribution peut se
justifier ainsi: une partie des redevances prélevées
sur les pollueurs dont les coûts d'épuration sont les
plus faibles; ainsi le coût global d'épuration est
minimisé non seulement par la redevance incitative mais aussi
par la redistribution des fonds collectés.
En plus des redevances, il
existe d'autres systèmes de taxation qui ne sont pas des
redevances au sens de la définition donnée au-dessus.
Les systèmes de consignations appliquées à des
produits potentiellement polluants permettent d'éviter la
pollution par retour du produit vers un collecteur. Le système
de consignation, très répandu en ce qui concerne les
bouteilles de verre, s'étend progressivement à d'autres
produits. L'efficacité du système est mesuré par
le pourcentage de retour des produits consignés. Ce système
peut être considéré comme une forme d'application
du principe pollueur payeur dans la mesure où les
consommateurs paient une certaine somme pour une pollution qu'ils
sont susceptibles de provoquer, somme qui leur est restituée
en cas de non pollution. Son avenir, en tant qu'instrument préventif,
est considéré comme prometteur même s'il se
révèle, dans les faits, moins efficace que la
réglementation directe. Le prix optimal de la consigne doit
être égale au coût collectif des déchets
non restitués.
 Il
existe aussi un système qui prend appui sur les péages
et droit d'entrée. Dans le domaine des transports, le péage,
les droits d'entrée dans le centre-ville, les taxes de
stationnement peuvent être évoqués comme
instruments fiscaux d'une politique de protection de l'environnement.
Les progrès en matière électronique offrent de
nouvelles possibilités à ce type d'instrument,
notamment en permettent de faire varier le montant du péage
selon les lieux et les heures de la journée. Lorsqu'on impose
un péage aux usagers, il est nécessaire que, dans le
même temps, un substitut soit proposé à ces
derniers, afin que l'effet incitatif soit conservé. Si les
recettes du péage sont utilisées aux financement
d'alternatives, l'impact est positif. Mais si elles servent à
fiancer de nouvelles infrastructures, comme c'est le cas dans le
domaine autoroutier, l'impact environnemental peut être nul,
voir négatif.
Il
existe aussi un système qui prend appui sur les péages
et droit d'entrée. Dans le domaine des transports, le péage,
les droits d'entrée dans le centre-ville, les taxes de
stationnement peuvent être évoqués comme
instruments fiscaux d'une politique de protection de l'environnement.
Les progrès en matière électronique offrent de
nouvelles possibilités à ce type d'instrument,
notamment en permettent de faire varier le montant du péage
selon les lieux et les heures de la journée. Lorsqu'on impose
un péage aux usagers, il est nécessaire que, dans le
même temps, un substitut soit proposé à ces
derniers, afin que l'effet incitatif soit conservé. Si les
recettes du péage sont utilisées aux financement
d'alternatives, l'impact est positif. Mais si elles servent à
fiancer de nouvelles infrastructures, comme c'est le cas dans le
domaine autoroutier, l'impact environnemental peut être nul,
voir négatif.
La consignation comme le
péage sont deux instruments appliqués, pour le moment,
de manière limitée: la consignation est réservée
à des produits aisément recyclables et présentant
un intérêt industriel, alors qu'elle pourrait
s'appliquer efficacement à des produits polluants demandant à
être traités (les huiles, par exemple); le péage,
quant à lui, est trop souvent utilisé dans un but
uniquement financier, son impact environnemental étant
inexistant.
Les états disposent
aussi d'aides financière qui ont pour but d'encourager les
agents à modifier leurs comportements. Généralement
trois types d'aides peuvent être recensées:
Les
subventions, qui ne donnent lieu à aucun remboursement et qui
sont versées en échange de mesures visant à
améliorer l'état de l'environnement.
Le
prêts à intérêts réduits, qui
abaissent le coût de certains investissements anti-pollution.
Les
allègements fiscaux, qui peuvent prendre diverses formes et
dont l'effet est sensiblement identique à celui des prêts
bonifiés.
Ces aides financières
sont en général couplées aux redevances, les
secondes fournissant les ressources nécessaires au paiement
des premières. Les aides peuvent être soit
proportionnelles aux quantités de pollution évitées
ou retenues, soit fixées forfaitairement.
L'incompatibilité
entre aides financières et principe pollueur payeur a fait
l'objet de nombreuses discussions. Pour que les aides financières
ne dérogent pas au principe pollueur payeur, elles doivent
être transitoires, limitées aux groupes cibles et
proposées seulement si des difficultés sérieuses
apparaissent en cas d'absence de soutien; en outre, elles ne doivent
pas entraîner de distorsion dans les échanges
internationaux. En pratique, les aides financières sont de
plus en plus utilisées dans les politiques environnementales
car le faible effet incitatif de certaines redevances rend nécessaire
le recours à la redistribution afin d'atteindre les objectifs
environnementaux.
b
) Un exemple concret : l'éco-efficience
L'éco-efficience est
un indicateur récent qui tend à se développer et
à s'imposer. Son mode de calcul est simple: volume de la
production divisée par la quantité d'émission ou
volume de la production divisée par la quantité
consommée.
Les émissions en
question sont bien sûr polluantes, de même que les
consommations sont d'ordre environnementale (énergie...).
La mesure des performances
écologiques des entreprises est un préalable
indispensable pour une politique de protection de la planète.
Les états ont donc
plusieurs outils fiscaux pour accompagner leur politique
environnementale. Face aux contraintes du développement, ils
doivent intervenir pour sauvegarder l'environnement. Ils déposent
pour cela d'un outil complémentaire: la réglementation.
Devant l'ampleur de l'enjeu planétaire, les états
doivent dans ce domaine arriver à une coordination efficace.
Actuellement, on constate une progression de la pratique de la mesure
des performances écologiques des processus économiques.
Ces mesures tentent de quantifier précisément la
consommation et les rejets des entreprises. Elles peuvent être
utilisée dans tout type de politiques écologiques,
qu'il s'agisse aussi bien de suivre une norme, d'imposer des taxes ou
de créer des marchés de permis. C'est d'ailleurs la
commission européenne qui en 2002 a fait le point sur ces
émissions et consommations dans l'industrie manufacturière.
 Même
si les progrès en matière environnementale sont souvent
lents, on sait désormais que si la volonté politique y
est, ils peuvent être obtenus rapidement. Ainsi, par exemple,
les émissions de gaz acidifiants (c'est-à-dire
essentiellement les composées souffrés) sont
responsables des pluies acides menaçant les forêts. En
Europe, depuis les années 80, on constate une diminution de
2/3. L'éco-efficience a été multiplié par
quatre. Par contre, concernant les émissions de CO2,
les progrès ne sont pas du même ordre: baisse de
seulement 11% depuis 1985. L'éco-efficience a augmenté
de 40%. Le constat est qu'il faudrait diminuer les émissions
de CO2 de 60% pour stabiliser l'effet de serre.
Même
si les progrès en matière environnementale sont souvent
lents, on sait désormais que si la volonté politique y
est, ils peuvent être obtenus rapidement. Ainsi, par exemple,
les émissions de gaz acidifiants (c'est-à-dire
essentiellement les composées souffrés) sont
responsables des pluies acides menaçant les forêts. En
Europe, depuis les années 80, on constate une diminution de
2/3. L'éco-efficience a été multiplié par
quatre. Par contre, concernant les émissions de CO2,
les progrès ne sont pas du même ordre: baisse de
seulement 11% depuis 1985. L'éco-efficience a augmenté
de 40%. Le constat est qu'il faudrait diminuer les émissions
de CO2 de 60% pour stabiliser l'effet de serre.
En ce qui concerne la
consommation de minerais, les résultats sont encore plus
limités. Les consommations ont augmentés de 15% depuis
1985, de même que l'éco-efficience de 14%. L'économie
est trop « matérielle ». Le gaspillage
et le pillage des ressource minérales pèsent sur la
planète.
La commission européenne
procède également à une comparaison entre
l'Europe et les Etats-Unis. On constate que pour un euro produit, les
américains consomment 2,3 fois plus d'énergie, émettent
2,5 fois plus de gaz acidifiant et presque 3 fois plus de gaz à
effet de serre.
La « vieille »
économie américaine a donc, il est clair, de sérieux
progrès à faire pour se rendre moins polluante et moins
gaspilleuse. Le seul point où elle domine concernant
l'environnement est son niveau d'émission des oxydes d'azote,
responsable des alertes à l'ozone. Dans ce domaine les
américains font presque 2 fois mieux que les européens.
Ils ont une avance en matière de norme et législation:
Clean Air Act (1997), Clean Air Amendment Act (1990).
Dans nos économies
de plus en plus tertiaire, l'industrie manufacturière ne
constitue plus le seul enjeu en matière d'éco-efficience.
Les consommations et rejets des bureaux et commerces représentent
des enjeux non négligeable. L'éclatement géographique
des lieux de consommation et d'émission rend plus complexe
cependant leur suivi.
La voie du développement
durable passe par le suivi des consommations et émissions de
toutes les entreprises. Des entreprises publient même déjà
d'elles-mêmes des rapports environnementaux annuels. Reste à
établir un cadre normalisé et législatif rendant
comparable ces résultats, comme pour les résultats
financiers. En France, les lois sur les régulations
économiques rendent ces rapports obligatoire pour les grandes
entreprises côtées à partir de 2003.
Les états ont donc
plusieurs outils fiscaux pour accompagner leur politique
environnementale. Face aux contraintes du développement, ils
doivent intervenir pour sauvegarder l'environnement. Ils déposent
pour cela d'un outil complémentaire : la réglementation.
Devant l'ampleur de l'enjeu planétaire, les états
doivent dans ce domaine arriver à une coordination efficace.
B
- Au niveau mondial
La coopération
mondiale en matière environnementale nécessite un
dialogue internationale. Plus contraignant que les outils fiscaux
dont disposent les états, la réglementation collective
est nécessaire car les dommages causés à
l'environnement ne se limite pas aux frontières. On constate
donc une coopération internationale accrue vers la fin du
20ème siècle. De plus, de nouveau mouvement
apparaissent et font pressions sur les décideurs
internationaux.
1)
La coopération internationale
A la différence
des instruments dit « économiques », les
réglementations ne laissent en principe aucun chois
d'ajustement (par exemple, payer la taxe ou dépolluer) aux
agents à qui elles sont imposées. Dans la pratique, il
s'agit de toutes les mesures d'ordre institutionnel visant à
réglementer les procédés ou les produits
utilisés, à interdire ou limiter les rejets de certains
polluants, à contrôler certaines activités en
imposant des autorisations, des normes, etc. Chaque état a sa
propre réglementation. Mais, comme le préservation de
l'environnement nécessite des actions dépassant le
simple cadre national, les états tentent de se rapprocher pour
Suvrer en commun.
 La
réglementation utilise deux outils principaux; les normes et
les labels.
La
réglementation utilise deux outils principaux; les normes et
les labels.
En matière de
protection de l'environnement, on distingue traditionnellement quatre
types de normes visant à limiter les diverses pollutions:
Les
normes d'émission ou de rejet visent à obliger les
pollueurs (ou les pollueurs potentiels) à ne pas déverser
dans l'environnement plus d'une certaine quantité de
polluants. Certaines de ces normes s'adressent à tout le
monde de manière indifférenciée, d'autres
s'appliquent à des pollueurs nommément identifiés.
Les normes d'émission sont très nombreuses,
particulièrement dans les domaines liés à la
pollution de l'air et au bruit, et peuvent aller, dans des cas
extrêmes, jusqu'à l'interdiction totale (certains
produits phytosanitaires utilisés en agriculture ont été
ainsi complètement interdits). Pour être écologiquement
efficace, les normes d'émissions ne doivent pas porter sur
des degrés de concentration, mais sur des rejets totaux, car
les normes portant sur des degrés de concentration permettent
aux pollueurs de diluer la pollution.
Les
normes de procédés ou de processus visent à
rendre obligatoire l'utilisation de technologies spécifiques
pour réduire les émissions, pour épurer ou même
produire (le pot catalytique pour les automobiles en est
l'illustration). Ces normes peuvent être, dans certains cas,
un substitut aux normes d'émission quand le contrôle
s'avère trop difficile. En termes technologiques, on peut
distinguer normes de procédés et normes de
performance. Les secondes, qui laissent plus ouvert le choix des
technologies, sont préférables puisqu'elles
encouragent mieux l'innovation.
Les
normes de produits fixent les caractéristiques auxquels
doivent répondre les produits.
Les
normes de qualité ne concernent pas les produits ou les
processus mais spécifient les caractéristiques des
milieux récepteurs de l'environnement. Elles constituent
souvent des objectifs qui servent de base aux politiques et,
notamment, à l'élaboration des autres types de normes
(émission, processus, produit). Les normes de qualité
sont très utilisées dans le cadre de l'Union
Européenne, la mise ne Suvre des instruments opératoires
étant laissée au soin de chaque état.
Le problème
du contrôle des normes est évoqué par tout les
auteurs. Si les contrôles et les sanctions en cas de
non-respect sont nécessaires, il y a unanimité pour
constater que les contrôles et les sanctions sont en pratique
insuffisants pour imposer le respect des normes. De plus, celles-ci,
étant souvent l'objet de négociations, constituent
généralement des compromis entre intérêts
contradictoires et peuvent donc, pour cette raison, être
insuffisamment contraignante par rapport à l'objectif
environnemental qui les a motivées.
Pour compléter
l'action des normes les labels sont apparus. Depuis quelques années,
des produits « verts » et des « écoproduits »
sont de plus en plus souvent proposés aux consommateurs. Du
côté de la production, des technologies « sobres »,
« propres » ou « respectueuses de
l'environnement » sont recherchés également,
à la fois parce qu'elles sont souvent des conditions
nécessaires à l'obtention d'un label écologique
du produit, parce qu'elles peuvent être source d'économies,
et parce qu'elles ont pour vocation d'anticiper des changement qui
pourraient s'imposer dans les modes de production, du fait d'un
durcissement possible des contraintes liées à la
protection de l'environnement.
L'efficacité
de la labellisation sur le plan environnemental, bien qu'encore mal
évaluée, semble reposer davantage sur la sensibilité
écologique du consommateur que sur l'effet marginal (très
faible) qu'a sur lui la pollution attachée au produit. Il en
est ainsi, par exemple, des lessives sans phosphates, des piles sans
mercure et de tous les emballages « verts ».
Rares sont, au fond, le cas où le seul effet marginal peut
suffire à inciter le consommateur à choisir un produit
labellisé (citons toutefois les exemples de peintures sans
solvants, ou de produits alimentaires issus de cultures sans
pesticides ni engrais chimiques).
En termes
économiques, la labellisation entraîne un ensemble de
coûts: coûts de fabrication de produits plus favorables à
la préservation de l'environnement, coûts administratifs
de labellisation et coûts de contrôle. Ces coûts
sont généralement répercutés par le
producteur sur le consommateur puisque les produits sont vendus plus
chers. Concernant les contrôles, ceux-ci sont indispensables à
l'efficacité d'une labellisation. Ils peuvent être
effectués soit par l'administration, soit par des organismes
indépendants.
Occupés à
préserver leur environnement par des réglementations,
les états se sont mis d'accord sur des axiomes qui servent de
bases pour leurs objectifs environnementaux communs.
Ce n'est que
tardivement que cette coopération c'est mise en place. En
fait, ce n'est que tardivement que l'homme s'est soucié de
l'environnement. Selon D. Worster, « l'âge
écologique a commencé dans le désert du nouveau
Mexique près d'Alamogardo le 16 juillet 1945 avec une boule de
feu aveuglante et un gros champignon de gaz radioactif ».
Le premier grand
drame de l'environnement c'est passé au Japon à
Minamoto. Il s'agit d'une intoxication collective sur la période
de 1950 à 1959, conduisant à plus de 1100 décès.
Dans la baie de Minamoto, une usine chimique rejetait dans l'eau des
sels mercurique, ni dangereux pour l'homme, ni pour les poissons.
Mais dans l'eau, ce sel devenait un produit toxique qui s'infiltrait
dans la chaîne alimentaire. Cette tragédie a permis de
mettre en évidence des effets qui n'avaient pas été
pris en compte. D'abord c'est l'existence d'un effet de synergie,
c'est-à-dire l'association de deux produits qui augmentent les
externalités. Ensuite des effets de seuils sont apparus. Il
existe donc un seuil au-delà duquel des effets négatifs
se manifestent, c'est-à-dire que dans la relation dose-effet à
une certaine dose il n'y a pas d'effets néfastes. Puis on
remarque un effet d'irréversibilité. Pour une période,
l'écosystème est perturbé par un effet.
Finalement il y a un effet de concentration, de tel sorte que
l'accumulation peut être destructrice pour le dernier maillon,
comme cela le fut à Minamoto.
Conscients des
risques menaçants les hommes, les gouvernement se sont plus ou
moins associé dans leur luttent. Des débats commencent
sur les limites de la croissance et la crise de l'environnement.
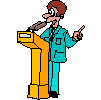 En
juin 1972, une conférence est organisée à
Stockholm (Suède): « Conférence Mondiale sur
l'Environnement Humain ». Deux thèmes principaux
ressortent. Le premier thème est l'unité planétaire.
Le rapport préparatoire rédigé par René
Dubos et Barbara Ward s'intitulait « Nous n'avons qu'une
Terre ». Selon René Dubos, les problèmes qui
affectent la Terre « doivent être abordés
sous l'angle mondial. Au moment où nous entrons dans
l'évolution sociale, il apparaît que chacun de nous a
deux pays: le sien propre et la planète Terre ». Le
second thème est la pauvreté. Il est considéré
comme le problème essentiel de la majorité de
l'humanité. Depuis 1968, des pays sont réticents à
cette conférence. Les pays en voie de développement
pensent que la pollution est une maladie des riches. Indira Gandhi,
porte parole des pays non-alignés, explique qu' « on
ne peut pas améliorer l'environnement là où
règne la misère. Et on ne peut pas éliminer la
misère sans le concours de la science et la technique ».
Ainsi on conclue de la conférence que la plupart des problèmes
environnementaux viennent du sous-développement.
En
juin 1972, une conférence est organisée à
Stockholm (Suède): « Conférence Mondiale sur
l'Environnement Humain ». Deux thèmes principaux
ressortent. Le premier thème est l'unité planétaire.
Le rapport préparatoire rédigé par René
Dubos et Barbara Ward s'intitulait « Nous n'avons qu'une
Terre ». Selon René Dubos, les problèmes qui
affectent la Terre « doivent être abordés
sous l'angle mondial. Au moment où nous entrons dans
l'évolution sociale, il apparaît que chacun de nous a
deux pays: le sien propre et la planète Terre ». Le
second thème est la pauvreté. Il est considéré
comme le problème essentiel de la majorité de
l'humanité. Depuis 1968, des pays sont réticents à
cette conférence. Les pays en voie de développement
pensent que la pollution est une maladie des riches. Indira Gandhi,
porte parole des pays non-alignés, explique qu' « on
ne peut pas améliorer l'environnement là où
règne la misère. Et on ne peut pas éliminer la
misère sans le concours de la science et la technique ».
Ainsi on conclue de la conférence que la plupart des problèmes
environnementaux viennent du sous-développement.
Cette même
année, à la demande du Club de Rome, une équipe
du Massachusetts Institute of Technology publie « The
Limits to Growth » sous la direction de Dennis Meadows.
Ces chercheurs se basent sur un modèle informatique comportant
cinq facteurs: les ressources naturelles, la production de
nourriture, la production industrielle, la pollution, la population.
En considérant l'évolution de ces facteurs d'ici 2100
sous différentes hypothèses, on assiste à un
effondrement du niveau de vie en deçà du niveau de
1900. Le seul cas satisfaisant est celui comportant les hypothèses
suivantes: stabilisation de la population par contrôle des
naissances, augmentation de la durabilité des produits,
recyclage généralisé, réduction de la
pollution au quart de ce qu'elle était en 1970, stabilisation
de la production avec détournement d'une partie de
l'investissement industriel vers l'agriculture et les services... La
seul solution apparaît donc être la croissance zéro.
Toutefois, l'ouvrage
« The Limits of Growth » fut vite critiqué.
En effet, les données présentées sont fragiles.
Certaines idées sont simplificatrices (constance du progrès
technique...). Au total, on a critiqué la fausse alternative
que propose les auteurs, c'est-à-dire soit la croissance avec
ses conséquences catastrophique, soit la qualité de
l'environnement mais avec une croissance zéro. Les auteurs
confondent deux problèmes différents: le taux de
croissance et le taux d'exploitation de la nature. En 1975 Alfred
Sauvy déclare: « c'est aussi par erreur que
l'Amérique a été découverte ».
S'il y a des choses erronées dans ce rapport, on ne peut pas
affirmer que les inquiétudes des auteurs soient dénuées
de fondements.
Durant la décennie
80 du siècle dernier, on assiste a une montée des
problèmes globaux. Le phénomène des pluies
acides est abordé aux conférences d'Ottawa et de Munich
(1984). C'est une prise de conscience que les pollutions sont
transfrontalières. En 1985, la conférence de Villach
(Autriche) s'intéresse aux problèmes de l'effet de
serre. Suite à l'article de Forman, le protocole de Montréal
en 1987 se « penche » sur le trou dans la
couche d'ozone. Un accord multilatéral est pris concernant
l'arrêt de la production de CFC et la mise en place d'aide dans
ce domaine pour les pays en développement.
En 1987, une
nouvelle notion apparaît dans les débats internationaux:
le développement durable. Cette expression vient du rapport
Brundtland, « Our Common Futur ». Cet rapport,
réalisé pour la Commission Mondiale sur l'Environnement
et le Développement (crée en 83), cherche à
faire la jonction entre problèmes d'environnement et problèmes
de développement. La définition de « développement
durable » par ce rapport est: « un
développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. Deux concept sont inhérents
à cette notion:
Le
concept de « besoins », et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis,
à qui il convient d'accorder la plus grande priorité,
et
Il s'agit donc d'une
soutenabilité environnementale et sociale, et en même
temps une équité et une solidarité
intergénérationnelle et intergénérationnelle.
En 1992, c'est
« l'Earth Summit » ou « Rio
Summit ». La conférence de Rio de Janeiro (Brésil)
ne se limite pas comme celle de Stockholm à l'environnement,
mais elle concerne aussi le développement. Plusieurs idées
fortes sont adoptées:

« l'Agenda
21 » (c'est-à-dire pour le 21ème siècle)
est adopté (800 pages). Il est structuré par un seul
référant théorique, celui de l'ouverture
économique et de la libéralisation des échanges
comme conditions du développement soutenable. Cet agenda
connaît des applications locales dans chaque pays.
Déclaration
de Rio qui défend le principe de développement durable
et le principe de précaution. Le principe de précaution
implique qu'en cas de risque, il faut s'abstenir. C'est un inversion
de la charge de la preuve en matière de risque. Tout choix
industriel ou politique devient un choix sociétal. Comme les
incertitudes scientifiques ne peuvent pas être toute levées,
la décision en choix économiques et politique devient
complexe et difficile.
 Finalement,
en 2002, le sommet mondial sur le développement durable vient
de s'achevé à Johannesburg sur une rafale de discours
et de communiqués de presse. Des discussions, des débats
et, parfois, des désaccords, est né un impressionnant
consensus international sur la façon dont les gouvernements,
les organisations internationales, la société civile et
les entreprises peuvent s'atteler de concert au renforcement des
trois piliers du développement durable : la croissance
économique soutenue, des investissements rationnels dans les
peuples et une protection éclairée de l'environnement.
Dans le plan de mise en Suvre adopté au sommet, les pays
développés et en développement ont adopté
une vision commune du développement durable qui aidera à
ouvrir nos économies et nos sociétés à la
croissance, garantira liberté et sécurité aux
générations actuelles et futures, offrira aux peuples
du monde entier la possibilité d'être en bonne santé
et de mener une vie productive, et assurera une bonne gestion des
ressources naturelles de la planète. Les participants au
sommet ont adopté un plan d'action ambitieux, mais réaliste,
qui vise à fournir de l'eau potable à ceux qui vivent
dans la misère, à inverser la tendance à
l'appauvrissement de la biodiversité, à stopper la
propagation du VIH/sida et autres maladies transmissibles, à
reconstituer les populations de poissons et autres actions destinées
à sortir les gens de la pauvreté. Le sommet a également
souligné le rôle clé des femmes en tant que
planificatrices, actrices et bénéficiaires du processus
de développement. Le plan de mise en Suvre s'appuie sur la
perspicacité dont a fait preuve le président Bush lors
de la conférence sur le financement du développement
qui s'est tenue à Monterrey en mars dernier. Dans le consensus
de Monterrey, les dirigeants du monde ont affirmé d'un commun
accord que l'engagement envers le développement commençait
chez soi, et que les ressources du secteur privé alimentaient
le progrès. Ces dirigeants ont alors également convenu
que la communauté internationale soutiendrait les efforts de
création des conditions nécessaires, en matière
de politique et de gouvernance, au déblocage de nouvelles
ressources, de possibilités et de talents en vue du
développement durable. Les États-Unis et l'Union
européenne ont promis de consacrer de nouvelles ressources
supplémentaires considérables à l'appui de ce
consensus.
Finalement,
en 2002, le sommet mondial sur le développement durable vient
de s'achevé à Johannesburg sur une rafale de discours
et de communiqués de presse. Des discussions, des débats
et, parfois, des désaccords, est né un impressionnant
consensus international sur la façon dont les gouvernements,
les organisations internationales, la société civile et
les entreprises peuvent s'atteler de concert au renforcement des
trois piliers du développement durable : la croissance
économique soutenue, des investissements rationnels dans les
peuples et une protection éclairée de l'environnement.
Dans le plan de mise en Suvre adopté au sommet, les pays
développés et en développement ont adopté
une vision commune du développement durable qui aidera à
ouvrir nos économies et nos sociétés à la
croissance, garantira liberté et sécurité aux
générations actuelles et futures, offrira aux peuples
du monde entier la possibilité d'être en bonne santé
et de mener une vie productive, et assurera une bonne gestion des
ressources naturelles de la planète. Les participants au
sommet ont adopté un plan d'action ambitieux, mais réaliste,
qui vise à fournir de l'eau potable à ceux qui vivent
dans la misère, à inverser la tendance à
l'appauvrissement de la biodiversité, à stopper la
propagation du VIH/sida et autres maladies transmissibles, à
reconstituer les populations de poissons et autres actions destinées
à sortir les gens de la pauvreté. Le sommet a également
souligné le rôle clé des femmes en tant que
planificatrices, actrices et bénéficiaires du processus
de développement. Le plan de mise en Suvre s'appuie sur la
perspicacité dont a fait preuve le président Bush lors
de la conférence sur le financement du développement
qui s'est tenue à Monterrey en mars dernier. Dans le consensus
de Monterrey, les dirigeants du monde ont affirmé d'un commun
accord que l'engagement envers le développement commençait
chez soi, et que les ressources du secteur privé alimentaient
le progrès. Ces dirigeants ont alors également convenu
que la communauté internationale soutiendrait les efforts de
création des conditions nécessaires, en matière
de politique et de gouvernance, au déblocage de nouvelles
ressources, de possibilités et de talents en vue du
développement durable. Les États-Unis et l'Union
européenne ont promis de consacrer de nouvelles ressources
supplémentaires considérables à l'appui de ce
consensus.
La difficulté
consiste maintenant à passer de Rio, Monterrey et Johannesburg
à l'avenir par le truchement d'actions concrètes. Comme
le secrétaire d'État américain l'a affirmé
à Johannesburg : « Les plans, c'est une bonne chose.
L'action, c'est encore mieux. Seule l'action permettra de donner à
boire à l'enfant assoiffé, empêchera la
transmission d'un virus mortel de la mère à son enfant,
et préservera la biodiversité d'un fragile écosystème
africain. ».
Certaines villes
prennent des mesures pour la mise en place d'un agenda 21. Même
si le nombre de communes en France agissant de la sorte n'est que de
150, une prise de conscience est en train d'émerger.
Par exemple, la
Communauté d'agglomération de Poitiers vient de créer
son conseil de développement durable. Ce conseil organisé
autour d'un débat avec la population, vise à faire
converger politiques économique, sociale et environnementale.
L'association 4D (Dossiers Débat pour le Développement
Durable) a développé dans son ouvrage : « Repères
pour un agenda 21 local », ce qu'est une ville durable. Voici
quels en sont les objets principaux :
1
-Aménagement de l'espace.
· Courtes
distances.
· Mieux
desservir les urbanisations (transports public).
· Rapprocher
le lieu de travail de l'habitat.
2
- Développement social urbain (quartiers en
difficulté).
· Augmenter
l'offre de logements.
· Favoriser
l'accès au services urbains.
· Lutter
contre l'exclusion par des plans locaux d'insertion économiques
(PLIE).
3
- Développement d'activité économique
et de l'emploi.
· Encourager
les gestions mutualisées par plusieurs entreprises proches
(approvisionnement,
transport des salariés...).
· Privilégier
les appels d'offres contenant des clauses environnementales.
4
- Déplacements.
· Limiter
l'usage de la voiture (transports en commun).
· Viser
l'équité : tarification selon le statut.
5
- Ecogestion des ressources, de l'énergie et des
déchets.
· Limiter les
consommation énergétiques
· Tri des
déchets et limitation
· Gérer
les espaces verts au cSur des villes.
6
- Faire participer les populations de toutes origines, à
la vie locale.
Cependant, on
remarque que la France est très en retard par rapport à
des pays comme la Suède ou le Danemark dans l'implication des
collectivités locales aux problèmes environnementaux.
Il a fallut attendre 1997 pour qu'en France un plan soit lancé
et financé par le ministère de l'environnement et de
l'aménagement du territoire. Un 2ème appel a été
lancé en Janvier 2000 ; de plus le contexte juridique est de
plus en plus favorable avec la «loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du
territoire», qui offre le cadre de ces projets cités
précédemment ; ainsi que la loi CHEVENEMENT sur la
communauté d'agglomérations et la loi «solidarité
et renouvellement urbain». Dans les villes, le problème
vient souvent de l'implication des entreprises dans la mise en place
d'un agenda 21.
 Pour
compléter l'action des états, de nombreux mouvements
non-gouvernementaux se sont mobilisés.
Pour
compléter l'action des états, de nombreux mouvements
non-gouvernementaux se sont mobilisés.
On remarque, à
travers le monde et durant ces trois dernières décennies,
la prolifération de mouvements dont les adhérents se
réclament comme étant « citoyens du monde ».
Plus ou moins impliqués dans les négociations
internationales, ces mouvements cherchent à faire prendre
conscience à nos sociétés modernes le danger
latent que représente une insouciance vis à vis de la
préservation de l'environnement. Ils prennent généralement
une forme associative, plus connue sous le terme d'organisation
non-gouvernementale .
C'est en 1992 à
Rio de Janeiro que pour la première ces mouvements purent
participer à certains débats. Ainsi, plus de 1 500
organisations non gouvernementales (ONG) ont participé
directement à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUED) ou indirectement,
au Forum global qui se tenait parallèlement à la
conférence. Lors du processus préparatoire de la CNUED,
les États avaient, pour la première fois, accepté
de laisser jouer aux ONG un rôle significatif lors de
négociations multilatérales, autorisant même leur
présence lors des rencontres officieuses. L'importance du rôle
des ONG en tant que "partenaires du développement
durable par l'amélioration des structures et de mécanismes
permettant leur participation au dialogue avec les gouvernements et
les organisations internationales", est décrit au
chapitre 27 d'Agenda 21. Dans le cadre du processus préparatoire
au SMDD, l'influence des ONG a aussi été davantage
formalisée par lamise en place de ce que l'on désigne
comme le Dialogue multipartite entre parties prenantes.
 Les
ONG sont très actives et milites pour des objectifs précis.
Elles appellent les gouvernants à déployer la volonté
politique nécessaire afin d'éliminer la pauvreté
et stimuler le développement durable, et à s'entendre
sur un plan d'action visant à résoudre la "crise
de la mise en Suvre" des engagements de Rio. Ce plan d'action
pourrait s'inscrire dans une "entente globale" entre pays
du Nord et du Sud, tel que proposée par un certain nombre de
pays (notamment l'Union européenne). Les recommandations
faites par les ONG visent notamment :
Les
ONG sont très actives et milites pour des objectifs précis.
Elles appellent les gouvernants à déployer la volonté
politique nécessaire afin d'éliminer la pauvreté
et stimuler le développement durable, et à s'entendre
sur un plan d'action visant à résoudre la "crise
de la mise en Suvre" des engagements de Rio. Ce plan d'action
pourrait s'inscrire dans une "entente globale" entre pays
du Nord et du Sud, tel que proposée par un certain nombre de
pays (notamment l'Union européenne). Les recommandations
faites par les ONG visent notamment :
Un
renouvellement du partenariat Nord-Sud et de la vision qui a émergé
à Rio (lien entre l'environnement et le développement,
partenariat Nord-Sud, dialogue entre les gouvernements et la société
civile, équité entre les pays et entre les
générations, promotion des droits des personnes et des
communautés, etc.).
Une
approche équitable et durable de la gestion des ressources
naturelles (accès des populations vulnérables,
autochtones, femmes, populations rurales, etc. aux ressources).
La
démocratie, la participation populaire et le renforcement des
capacités institutionnelles.
Les
institutions internationales pour le développement durable
(renforcement de la gouvernance globale pour le développement
durable, respect des règles environnementales sur la base du
principe des responsabilités communes mais différenciées,
renforcement des institutions environnementales et sociales par
rapport à l'OMC et aux institutions financières
internationales).
Les
partenariats entre parties prenantes (réaffirmation de la
responsabilité des gouvernements, transparence,
responsabilité et ouverture du cadre des partenariats, examen
des partenariats, notamment ceux visant les grandes entreprises).
La
responsabilité des entreprises (qui devrait, selon les ONG,
être enchâssée dans un cadre juridique).
La
consommation, la production et le développement durables
(sensibilisation et protection des consommateurs, application des
principes de précaution et du pollueur payeur, entrée
en vigueur de taxes vertes, politique commerciale internationale
durable et équitable, etc.).
Le
financement du développement durable (atteinte de l'objectif
du consensus de Monterrey dans un délai raisonnable,
annulation de la dette des pays les plus endettés et
restructuration de la dette pour les autres, mise en place de
systèmes transparents pour assurer un usage efficient de
l'aide au développement, affectation des budgets militaires
vers l'éducation, la santé, et autres domaines
sociaux, amélioration des mécanismes multilatéraux
de financement pour le développement durable, transferts de
technologies).
Les
initiatives de développement durable en Afrique.
La
ratification des traités signés.
Les OGN sont
aujourd'hui des partenaires incontournables lors des débats
concernant les problèmes environnementaux. Elles sont devenues
des groupes de pression conséquents qui influent sur les
décisions prises lors des sommets environnementaux
internationaux entre les états.
2)
Quelques exemples
a
) Le problème de l'eau, des déchets et de
l'énergie
Pour
l'eau :
 Un
projet a été remis à la conférence
ministérielle de la Haye aux Pays-Bas en mars 2000. Ce rapport
«Vision mondiale de l'eau» (appelé projet
«vision») a été soutenu par toutes les
agences des Nations Unies.
Un
projet a été remis à la conférence
ministérielle de la Haye aux Pays-Bas en mars 2000. Ce rapport
«Vision mondiale de l'eau» (appelé projet
«vision») a été soutenu par toutes les
agences des Nations Unies.
Ce projet comporte 3
objectifs principaux :
Augmenter
la sensibilisation des populations et des décideurs afin
d'obtenir des résultats au niveau politique et
comportemental.
Mieux
gérer l'eau : sensibilisation des entreprises et Etats.
Fournir
la base d'un cadre d'action, pour passer de la «vision
mondiale de l'eau» à «l'action mondiale pour
l'eau».
Pour
les déchets, les décharges : une prise de conscience
 Nous
savons de nos jours que le « zéro déchet »
est une utopie irréalisable, cependant il faut agir vite et
limiter leur croissance. A défaut, il reste le « zéro
déchets à éliminer », avec du recyclage
intensif et de la récupération, mais le « tout
recyclage » est également une utopie. Pour les déchets
ménager, la seule solution serait de responsabiliser le
producteur vis à vis des produits et surtout des emballages.
Nous
savons de nos jours que le « zéro déchet »
est une utopie irréalisable, cependant il faut agir vite et
limiter leur croissance. A défaut, il reste le « zéro
déchets à éliminer », avec du recyclage
intensif et de la récupération, mais le « tout
recyclage » est également une utopie. Pour les déchets
ménager, la seule solution serait de responsabiliser le
producteur vis à vis des produits et surtout des emballages.
Pour les déchets
nucléaires, la séparation transmutation (diminution de
la durée de nocivité des déchets) semblerait
diminuer les risques mais ne résout qu'une partie du problème.
Pour
l'énergie :
Selon un rapport de
l'OCDE, jusque en 2020 les combustibles fossiles resteront
prépondérants dans la consommation d'énergie. la
consommation pétrolière aura un rôle de
combustible dit de «bouclage», c'est à dire pour
combler la brèche que les autres formes d'énergie
n'auront pas satisfaite. Ce ne sera qu'en 2050 que toutes les
technologies utilisées quotidiennement seront remplacées
(au moins 1 fois) par d'autres technologies, étant donné
que la population mondiale (prévisions) aura augmenté
de 2 milliards. Et comme nous le savons, la concentration croissante
de gaz à effet de serre dans l'air nécessite un
investissement dans de nouvelles technologies plus propres. la
croissance économique mondiale sur la période 1990-2025
est prévue pour atteindre 2.7%, ce qui devrait permettre une
marge pour la mutation structurelle nécessaire.
 3
scénarios (+1) semblent être possibles pour le futur :
3
scénarios (+1) semblent être possibles pour le futur :
Scénario
B : Il est caractérisé par une évolution
progressive des technologies, par la libéralisation des
échanges et le décollage des pays du sud. C'est aussi
le cadre de l'augmentation d'émission de CO2 suivi de
l'épuisement des ressources fossiles. Enfin des coûts
énormes de modification structurelle liés également
à l'environnement.
b
) Le nucléaire : une solution ?
Il existe un constat
commun à tous disant que le besoin en énergie risque de
beaucoup augmenter dans les prochaines décennies : PED
arrivent.
Cependant, même
si cette croissance de la consommation d'énergie est
inéluctable, des énergies fossiles ne sont pas viables
pour l'effet de serre.
De plus, comme le
faisait remarquer dans les années 50 les promoteurs du
nucléaire aux USA, le nucléaire nous donnerait une
énergie à si bas prix qu'il serait inutile de la
mesurer (too cheap to meter). Ainsi seul l'atome semble pouvoir
rapprocher l'offre de la demande, tout en restant propre et bon
marché.
Cependant, ce
secteur est en crise. Il existe 440 réacteurs dans le monde
fin 2001, et aucun projet de construction excepté en Finlande
n'existe. Le Japon et les USA qui tout deux étaient attendus
pour des projets n'ont rien concrétisé ; et des pays
comme l'Allemagne ont même opté pour une sortie du
nucléaire, préférant maîtriser leur
consommation et privilégiant les énergies
renouvelables. Les technologies utilisées dans le nucléaire
aujourd'hui ont 25 ans.
 Le
nucléaire comporte toutefois des risques. Ainsi, les épisodes
à la Tchernobyl ont fait trembler le monde et coûté
plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et Bélarus (
les terres contaminées biélorusse sont inhabitables de
nos jours, et ce pour plusieurs décennies). Aucune filière
nucléaire ne peut être considérée comme
sûre à 100% ; on évalue en France entre 1 et 10
sur 1million la probabilité d'un accident majeur par réacteur
et par an !
Le
nucléaire comporte toutefois des risques. Ainsi, les épisodes
à la Tchernobyl ont fait trembler le monde et coûté
plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et Bélarus (
les terres contaminées biélorusse sont inhabitables de
nos jours, et ce pour plusieurs décennies). Aucune filière
nucléaire ne peut être considérée comme
sûre à 100% ; on évalue en France entre 1 et 10
sur 1million la probabilité d'un accident majeur par réacteur
et par an !
De plus, les
attentats du 11 septembre nous font nous rappeler que chaque réacteur
est une bombe en puissance, et qu'ils ne sont pas conçus pour
résister à la chute d'un Boeing. des mesures ont été
prises en France avec le déploiement de batteries
anti-aériennes prés des réacteurs.
En ce qui concerne
les déchets on connaît maintenant les possibilités
de la transmutation, pour transformer des éléments
radioactifs à vie longue en éléments à
vie court ; Mais pas de réelles solution (à part des
entrepôts sous terre).
Pourquoi
le nucléaire n'est pas une solution ? Le nucléaire
n'a survécu jusqu'ici qu'a grands coups d'aides publiques. Or,
les règles du commerce international et le mouvement de
libéralisation de l'économie ont fait reculer ces
pratiques. Aucun réacteur n'a jamais été
commandé sur un marché de l'énergie ouvert à
la concurrence ; les coûts d'investissement trop élevés
sont incompatibles avec les risques.
Enfin, notre société
est trop gourmande en énergie, et c'est bien ce que montre
l'imperturbable croissance de carbone dans l'air chaque jour. Le
nucléaire s'inscrit dans un sens sur ce développement
non durable, construit sur la croissance de l'offre plutôt que
sur la maîtrise de la demande. Pour dernier exemple, les USA
représentent 5% de la population mondiale, 25% des émissions
en CO2 et 35% de la production électronucléaire ;
s'inscrivant dans cette logique de consommation et de production non
maîtrisée. De plus il a été calculé
qu'en multipliant par 5 le nombre de réacteurs (et donc de
déchets et de risques d'accidents) on baisserais seulement les
émissions de CO2 de 20 ou 30%. Ainsi la communauté
internationale a-t-elle décidé d'exclure le nucléaire
des mécanismes de réduction des gaz à effet de
serre à Kyoto.


[
Sommaire ]
 Ainsi,
lorsque les arbres sont abattus et vendus comme bois d'oeuvre, le
produit est comptabilisé comme recette, et donc ajouté
au PNB. Mais aucun débit correspondant à la dégradation
de la forêt n'est enregistré. Pourtant, si cette
ressources économique est bien gérée, elle
pourrait générer des revenus à long terme. Il en
résulte un sens exagéré de l'importance des
revenus et des richesses, ce qui créé une illusion que
le pays est dans une situation meilleure qu'il ne l'est en réalité
et qu'il peut supporter des niveaux de consommation plus élevés
qu'il n'est véritablement en mesure de la faire. R. Repetto,
économiste à l'Institut mondial des ressources, note
qu'en raison de cette incapacité à distinguer la
destruction de l'actif naturel de la production de revenus, le PNB
est comme un « phare trompeur, capable d'attirer sur les
rochers ceux qui passent à proximité ».
Ainsi,
lorsque les arbres sont abattus et vendus comme bois d'oeuvre, le
produit est comptabilisé comme recette, et donc ajouté
au PNB. Mais aucun débit correspondant à la dégradation
de la forêt n'est enregistré. Pourtant, si cette
ressources économique est bien gérée, elle
pourrait générer des revenus à long terme. Il en
résulte un sens exagéré de l'importance des
revenus et des richesses, ce qui créé une illusion que
le pays est dans une situation meilleure qu'il ne l'est en réalité
et qu'il peut supporter des niveaux de consommation plus élevés
qu'il n'est véritablement en mesure de la faire. R. Repetto,
économiste à l'Institut mondial des ressources, note
qu'en raison de cette incapacité à distinguer la
destruction de l'actif naturel de la production de revenus, le PNB
est comme un « phare trompeur, capable d'attirer sur les
rochers ceux qui passent à proximité ». Le
PNB, calculé comme il l'est aujourd'hui, est non seulement
aveugle à la destruction des richesses naturelles, mais il
présentent aussi un autre grand défaut : il
comptabilise comme recette nombre de dépenses effectuées
pour combattre la pollution et leur conséquences néfastes.
La marée noire
de Mars 1989 en Alaska qui, de toute l'histoire des
Etats-Unis, a été probablement l'accident le plus
dommageable pour les milieux naturels, a entraîné une
augmentation du PNB, puisque la majeure partie des 2,2 milliards de
dollars dépensés en main-d'oeuvre et en équipements
dans le cadre des opérations de nettoyage a été
ajoutée aux recettes. Tout aussi pervers est l'enregistrement
dans les recettes de la comptabilité nationale des soins
médicaux induits par la pollution atmosphérique,
englobés dans des dizaines de milliards de dollars dépensés
par les américains pour leur frais de santé.
Le
PNB, calculé comme il l'est aujourd'hui, est non seulement
aveugle à la destruction des richesses naturelles, mais il
présentent aussi un autre grand défaut : il
comptabilise comme recette nombre de dépenses effectuées
pour combattre la pollution et leur conséquences néfastes.
La marée noire
de Mars 1989 en Alaska qui, de toute l'histoire des
Etats-Unis, a été probablement l'accident le plus
dommageable pour les milieux naturels, a entraîné une
augmentation du PNB, puisque la majeure partie des 2,2 milliards de
dollars dépensés en main-d'oeuvre et en équipements
dans le cadre des opérations de nettoyage a été
ajoutée aux recettes. Tout aussi pervers est l'enregistrement
dans les recettes de la comptabilité nationale des soins
médicaux induits par la pollution atmosphérique,
englobés dans des dizaines de milliards de dollars dépensés
par les américains pour leur frais de santé. Pourtant,
l'utilisation plus fréquente des transports en commun et de la
bicyclette pour la plupart des déplacement améliorerait
la qualité de la vie urbaine, en éliminant les
embouteillages et en rendant les villes plus sûres pour les
piétons. Selon G. Hardin, écologiste et philosophe,
« s'efforcer de maximiser le PNB est à peu près
aussi sensé de la part d'un homme d'état que, pour un
compositeur, de chercher à mettre le plus de notes possible
dans uns symphonie ».
Pourtant,
l'utilisation plus fréquente des transports en commun et de la
bicyclette pour la plupart des déplacement améliorerait
la qualité de la vie urbaine, en éliminant les
embouteillages et en rendant les villes plus sûres pour les
piétons. Selon G. Hardin, écologiste et philosophe,
« s'efforcer de maximiser le PNB est à peu près
aussi sensé de la part d'un homme d'état que, pour un
compositeur, de chercher à mettre le plus de notes possible
dans uns symphonie ». L'IDH
évolue sans cesse ; en effet, dans certains cas, en raison des
perfectionnement apportés par l'équipe de l'ONU, le
classement connaît de notable différences d'une année
à l'autre. A mesure que de nouvelles données seront
disponibles, l'IDH en viendra à prendre en compte d'autres
facteurs de développement humain. Ainsi il existe suffisamment
d'informations pour inclure les inégalités entre les
sexes dans l'IDH. De la même manière, le classement
change quand on tient compte de la répartition des revenus.
L'IDH
évolue sans cesse ; en effet, dans certains cas, en raison des
perfectionnement apportés par l'équipe de l'ONU, le
classement connaît de notable différences d'une année
à l'autre. A mesure que de nouvelles données seront
disponibles, l'IDH en viendra à prendre en compte d'autres
facteurs de développement humain. Ainsi il existe suffisamment
d'informations pour inclure les inégalités entre les
sexes dans l'IDH. De la même manière, le classement
change quand on tient compte de la répartition des revenus. L'exemple
le plus courant concerne les subventions encourageant l'utilisation
des pesticides, sous différentes formes (dispenses
d'impôts...). En maintenant le prix des pesticides à un
niveau bas, les gouvernements cherchent à aider les
agriculteurs à limiter les dommages causés par les
prédateurs et à augmenter ainsi le rendement des
cultures. Mais cette pratique encourage du même coup une
utilisation excessive de ces produits, ce qui augmente le nombre de
décès et de maladies lié aux agents chimiques et
provoquent le déversement de quantités croissantes de
substances polluantes dans l'environnement. Qui plus est, ces
subventions freinent le développement et la mise en pratique
d'une gestion intégrée des prédateurs (recours
aux ennemis naturels des prédateurs, à une organisation
différente des récoltes, à des variétés
résistantes aux prédateurs et à d'autres moyens
de contrôle non chimiques permettant de stabiliser et même
d'augmenter les récoltes tout en minimisant les menaces pour
la santé et l'environnement).
L'exemple
le plus courant concerne les subventions encourageant l'utilisation
des pesticides, sous différentes formes (dispenses
d'impôts...). En maintenant le prix des pesticides à un
niveau bas, les gouvernements cherchent à aider les
agriculteurs à limiter les dommages causés par les
prédateurs et à augmenter ainsi le rendement des
cultures. Mais cette pratique encourage du même coup une
utilisation excessive de ces produits, ce qui augmente le nombre de
décès et de maladies lié aux agents chimiques et
provoquent le déversement de quantités croissantes de
substances polluantes dans l'environnement. Qui plus est, ces
subventions freinent le développement et la mise en pratique
d'une gestion intégrée des prédateurs (recours
aux ennemis naturels des prédateurs, à une organisation
différente des récoltes, à des variétés
résistantes aux prédateurs et à d'autres moyens
de contrôle non chimiques permettant de stabiliser et même
d'augmenter les récoltes tout en minimisant les menaces pour
la santé et l'environnement). Les
états ont un rôles essentiel a joué dans la
protection de l'environnement. En théorie, les institutions
nationales ont le recule nécessaire et les moyens de préserver
l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas des individus qui
maximisent leur utilité. Mais en pratique, il s'avère
malheureusement que certains gouvernements poursuivent des intérêts
dictés par une poignée d'individus qui ne cherche pas à
protéger le capital environnemental. Toutefois, depuis près
d'un demi siècle, on constate une prise de conscience général
des enjeux de l'environnement. Les états se sont mobilisés
pour sauvegarder leur milieu naturel.
Les
états ont un rôles essentiel a joué dans la
protection de l'environnement. En théorie, les institutions
nationales ont le recule nécessaire et les moyens de préserver
l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas des individus qui
maximisent leur utilité. Mais en pratique, il s'avère
malheureusement que certains gouvernements poursuivent des intérêts
dictés par une poignée d'individus qui ne cherche pas à
protéger le capital environnemental. Toutefois, depuis près
d'un demi siècle, on constate une prise de conscience général
des enjeux de l'environnement. Les états se sont mobilisés
pour sauvegarder leur milieu naturel. Même
si les progrès en matière environnementale sont souvent
lents, on sait désormais que si la volonté politique y
est, ils peuvent être obtenus rapidement. Ainsi, par exemple,
les émissions de gaz acidifiants (c'est-à-dire
essentiellement les composées souffrés) sont
responsables des pluies acides menaçant les forêts. En
Europe, depuis les années 80, on constate une diminution de
2/3. L'éco-efficience a été multiplié par
quatre. Par contre, concernant les émissions de CO2,
les progrès ne sont pas du même ordre: baisse de
seulement 11% depuis 1985. L'éco-efficience a augmenté
de 40%. Le constat est qu'il faudrait diminuer les émissions
de CO2 de 60% pour stabiliser l'effet de serre.
Même
si les progrès en matière environnementale sont souvent
lents, on sait désormais que si la volonté politique y
est, ils peuvent être obtenus rapidement. Ainsi, par exemple,
les émissions de gaz acidifiants (c'est-à-dire
essentiellement les composées souffrés) sont
responsables des pluies acides menaçant les forêts. En
Europe, depuis les années 80, on constate une diminution de
2/3. L'éco-efficience a été multiplié par
quatre. Par contre, concernant les émissions de CO2,
les progrès ne sont pas du même ordre: baisse de
seulement 11% depuis 1985. L'éco-efficience a augmenté
de 40%. Le constat est qu'il faudrait diminuer les émissions
de CO2 de 60% pour stabiliser l'effet de serre. La
réglementation utilise deux outils principaux; les normes et
les labels.
La
réglementation utilise deux outils principaux; les normes et
les labels.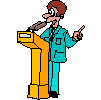 En
juin 1972, une conférence est organisée à
Stockholm (Suède): « Conférence Mondiale sur
l'Environnement Humain ». Deux thèmes principaux
ressortent. Le premier thème est l'unité planétaire.
Le rapport préparatoire rédigé par René
Dubos et Barbara Ward s'intitulait « Nous n'avons qu'une
Terre ». Selon René Dubos, les problèmes qui
affectent la Terre « doivent être abordés
sous l'angle mondial. Au moment où nous entrons dans
l'évolution sociale, il apparaît que chacun de nous a
deux pays: le sien propre et la planète Terre ». Le
second thème est la pauvreté. Il est considéré
comme le problème essentiel de la majorité de
l'humanité. Depuis 1968, des pays sont réticents à
cette conférence. Les pays en voie de développement
pensent que la pollution est une maladie des riches. Indira Gandhi,
porte parole des pays non-alignés, explique qu' « on
ne peut pas améliorer l'environnement là où
règne la misère. Et on ne peut pas éliminer la
misère sans le concours de la science et la technique ».
Ainsi on conclue de la conférence que la plupart des problèmes
environnementaux viennent du sous-développement.
En
juin 1972, une conférence est organisée à
Stockholm (Suède): « Conférence Mondiale sur
l'Environnement Humain ». Deux thèmes principaux
ressortent. Le premier thème est l'unité planétaire.
Le rapport préparatoire rédigé par René
Dubos et Barbara Ward s'intitulait « Nous n'avons qu'une
Terre ». Selon René Dubos, les problèmes qui
affectent la Terre « doivent être abordés
sous l'angle mondial. Au moment où nous entrons dans
l'évolution sociale, il apparaît que chacun de nous a
deux pays: le sien propre et la planète Terre ». Le
second thème est la pauvreté. Il est considéré
comme le problème essentiel de la majorité de
l'humanité. Depuis 1968, des pays sont réticents à
cette conférence. Les pays en voie de développement
pensent que la pollution est une maladie des riches. Indira Gandhi,
porte parole des pays non-alignés, explique qu' « on
ne peut pas améliorer l'environnement là où
règne la misère. Et on ne peut pas éliminer la
misère sans le concours de la science et la technique ».
Ainsi on conclue de la conférence que la plupart des problèmes
environnementaux viennent du sous-développement. Finalement,
en 2002, le sommet mondial sur le développement durable vient
de s'achevé à Johannesburg sur une rafale de discours
et de communiqués de presse. Des discussions, des débats
et, parfois, des désaccords, est né un impressionnant
consensus international sur la façon dont les gouvernements,
les organisations internationales, la société civile et
les entreprises peuvent s'atteler de concert au renforcement des
trois piliers du développement durable : la croissance
économique soutenue, des investissements rationnels dans les
peuples et une protection éclairée de l'environnement.
Dans le plan de mise en Suvre adopté au sommet, les pays
développés et en développement ont adopté
une vision commune du développement durable qui aidera à
ouvrir nos économies et nos sociétés à la
croissance, garantira liberté et sécurité aux
générations actuelles et futures, offrira aux peuples
du monde entier la possibilité d'être en bonne santé
et de mener une vie productive, et assurera une bonne gestion des
ressources naturelles de la planète. Les participants au
sommet ont adopté un plan d'action ambitieux, mais réaliste,
qui vise à fournir de l'eau potable à ceux qui vivent
dans la misère, à inverser la tendance à
l'appauvrissement de la biodiversité, à stopper la
propagation du VIH/sida et autres maladies transmissibles, à
reconstituer les populations de poissons et autres actions destinées
à sortir les gens de la pauvreté. Le sommet a également
souligné le rôle clé des femmes en tant que
planificatrices, actrices et bénéficiaires du processus
de développement. Le plan de mise en Suvre s'appuie sur la
perspicacité dont a fait preuve le président Bush lors
de la conférence sur le financement du développement
qui s'est tenue à Monterrey en mars dernier. Dans le consensus
de Monterrey, les dirigeants du monde ont affirmé d'un commun
accord que l'engagement envers le développement commençait
chez soi, et que les ressources du secteur privé alimentaient
le progrès. Ces dirigeants ont alors également convenu
que la communauté internationale soutiendrait les efforts de
création des conditions nécessaires, en matière
de politique et de gouvernance, au déblocage de nouvelles
ressources, de possibilités et de talents en vue du
développement durable. Les États-Unis et l'Union
européenne ont promis de consacrer de nouvelles ressources
supplémentaires considérables à l'appui de ce
consensus.
Finalement,
en 2002, le sommet mondial sur le développement durable vient
de s'achevé à Johannesburg sur une rafale de discours
et de communiqués de presse. Des discussions, des débats
et, parfois, des désaccords, est né un impressionnant
consensus international sur la façon dont les gouvernements,
les organisations internationales, la société civile et
les entreprises peuvent s'atteler de concert au renforcement des
trois piliers du développement durable : la croissance
économique soutenue, des investissements rationnels dans les
peuples et une protection éclairée de l'environnement.
Dans le plan de mise en Suvre adopté au sommet, les pays
développés et en développement ont adopté
une vision commune du développement durable qui aidera à
ouvrir nos économies et nos sociétés à la
croissance, garantira liberté et sécurité aux
générations actuelles et futures, offrira aux peuples
du monde entier la possibilité d'être en bonne santé
et de mener une vie productive, et assurera une bonne gestion des
ressources naturelles de la planète. Les participants au
sommet ont adopté un plan d'action ambitieux, mais réaliste,
qui vise à fournir de l'eau potable à ceux qui vivent
dans la misère, à inverser la tendance à
l'appauvrissement de la biodiversité, à stopper la
propagation du VIH/sida et autres maladies transmissibles, à
reconstituer les populations de poissons et autres actions destinées
à sortir les gens de la pauvreté. Le sommet a également
souligné le rôle clé des femmes en tant que
planificatrices, actrices et bénéficiaires du processus
de développement. Le plan de mise en Suvre s'appuie sur la
perspicacité dont a fait preuve le président Bush lors
de la conférence sur le financement du développement
qui s'est tenue à Monterrey en mars dernier. Dans le consensus
de Monterrey, les dirigeants du monde ont affirmé d'un commun
accord que l'engagement envers le développement commençait
chez soi, et que les ressources du secteur privé alimentaient
le progrès. Ces dirigeants ont alors également convenu
que la communauté internationale soutiendrait les efforts de
création des conditions nécessaires, en matière
de politique et de gouvernance, au déblocage de nouvelles
ressources, de possibilités et de talents en vue du
développement durable. Les États-Unis et l'Union
européenne ont promis de consacrer de nouvelles ressources
supplémentaires considérables à l'appui de ce
consensus. Pour
compléter l'action des états, de nombreux mouvements
non-gouvernementaux se sont mobilisés.
Pour
compléter l'action des états, de nombreux mouvements
non-gouvernementaux se sont mobilisés. Les
ONG sont très actives et milites pour des objectifs précis.
Elles appellent les gouvernants à déployer la volonté
politique nécessaire afin d'éliminer la pauvreté
et stimuler le développement durable, et à s'entendre
sur un plan d'action visant à résoudre la "crise
de la mise en Suvre" des engagements de Rio. Ce plan d'action
pourrait s'inscrire dans une "entente globale" entre pays
du Nord et du Sud, tel que proposée par un certain nombre de
pays (notamment l'Union européenne). Les recommandations
faites par les ONG visent notamment :
Les
ONG sont très actives et milites pour des objectifs précis.
Elles appellent les gouvernants à déployer la volonté
politique nécessaire afin d'éliminer la pauvreté
et stimuler le développement durable, et à s'entendre
sur un plan d'action visant à résoudre la "crise
de la mise en Suvre" des engagements de Rio. Ce plan d'action
pourrait s'inscrire dans une "entente globale" entre pays
du Nord et du Sud, tel que proposée par un certain nombre de
pays (notamment l'Union européenne). Les recommandations
faites par les ONG visent notamment : Un
projet a été remis à la conférence
ministérielle de la Haye aux Pays-Bas en mars 2000. Ce rapport
«Vision mondiale de l'eau» (appelé projet
«vision») a été soutenu par toutes les
agences des Nations Unies.
Un
projet a été remis à la conférence
ministérielle de la Haye aux Pays-Bas en mars 2000. Ce rapport
«Vision mondiale de l'eau» (appelé projet
«vision») a été soutenu par toutes les
agences des Nations Unies. 3
scénarios (+1) semblent être possibles pour le futur :
3
scénarios (+1) semblent être possibles pour le futur : Le
nucléaire comporte toutefois des risques. Ainsi, les épisodes
à la Tchernobyl ont fait trembler le monde et coûté
plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et Bélarus (
les terres contaminées biélorusse sont inhabitables de
nos jours, et ce pour plusieurs décennies). Aucune filière
nucléaire ne peut être considérée comme
sûre à 100% ; on évalue en France entre 1 et 10
sur 1million la probabilité d'un accident majeur par réacteur
et par an !
Le
nucléaire comporte toutefois des risques. Ainsi, les épisodes
à la Tchernobyl ont fait trembler le monde et coûté
plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine et Bélarus (
les terres contaminées biélorusse sont inhabitables de
nos jours, et ce pour plusieurs décennies). Aucune filière
nucléaire ne peut être considérée comme
sûre à 100% ; on évalue en France entre 1 et 10
sur 1million la probabilité d'un accident majeur par réacteur
et par an !

